-
Compteur de contenus
46 533 -
Inscription
-
Dernière visite
-
Jours gagnés
472
Type de contenu
Profils
Forums
Calendrier
Messages posté(e)s par lpm34
-
-
Cet article est le premier d’une série de deux articles relatifs à la course et à l’alésage et traite de la cylindrée et du taux de compression ; le couple moteur et la puissance sont traités dans le second article.
Cylindrée et taux de compression
Le cylindre est défini par deux constantes : l’alésage et la course.
L’alésage correspond au diamètre intérieur du cylindre. La course correspond à la distance parcourue par le piston entre le point mort bas (PMB) et le point mort haut (PMH).
Afin d’illustrer les divers calculs ci-dessous, nous avons utilisé les données constructeur de la Triumph Speed Triple 2004 :
* alésage : 79 mm
* course : 65 mm
* cylindrée totale : 955 cm³
* nombre de cylindre : 3
Cylindrée unitaire
Le volume déplacé par le piston est appelé cylindrée. On parlera ici de cylindrée unitaire car il s’agit du volume pour un cylindre. Pour calculer ce volume, on effectue le calcul suivant :
cu = (π × a² × c) ÷ 4
« cu » est la cylindrée unitaire, « π » est une constante égale à 3,14159…, « a » est l’alésage, « c » est la course et « 4 » un diviseur constant.
cu = (π × 79² × 65) ÷ 4
cu = (π × 6 241 × 65) ÷ 4
cu = 1 274 434,184 ÷ 4
cu = 318 608,55
Ce résultat est exprimé en mm³ ; la conversion en cm³ donne donc une valeur de 318,608 cm³ de cylindrée unitaire, que l’on arrondira à l’unité, soit 318 cm³.
Cylindrée totale
La cylindrée totale du moteur est logiquement égale à la cylindrée unitaire multipliée par le nombre de cylindre :
ct = cu × nc
« ct » est la cylindrée totale, « cu » est la cylindrée unitaire et « nc » est le nombre de cylindres.
ct = 318 608,55 × 3
ct = 955 825,65
Ce résultat est exprimé en mm³ ; la conversion en cm³ donne donc une valeur de 955,825 cm³ de cylindrée unitaire, que l’on arrondira à l’unité, soit 955 cm³.
Taux de compression
Lorsque le piston remonte dans le cylindre, et que les soupapes d’admissions et d’échappements sont fermées, la pression du mélange air / carburant augmente. Plus cette pression est importante, plus la combustion produit de force explosive. Exemple :
* cylindrée unitaire : 318 cm³
* volume d’une chambre de combustion : 26,5 cm³
Pour calculer le taux de compression « tc » il convient donc de diviser la cylindrée unitaire par le volume d’une chambre de combustion :
tc = 318 ÷ 26,5
tc = 12
Le taux de compression du moteur de la Triumph Speed Triple possède donc un rapport volumétrique de 12 à 1.
-
Les monocylindres
L’explosion nécessaire à la propulsion est dûe à la compression par le piston du mélange air / essence dans le cylindre. Le monocylindre est donc l’architecture de base de toute motorisation thermique. Si la conception de ce type de moteur est on ne peut plus simple, elle engendre des contraintes. Bien que les monocylindres évoluent sous l’influence de BMW et de ses 650 GS, la course du piston des monos atteind encore assez souvent les 90 mm. Il convient donc de ne pas rouler dans les tours afin de ne pas dépasser la vitesse linéaire fatidique des 30 m / s à plus ou moins 10 000 tr / min. A l’inverse le haut moteur tend à cogner quand il est sous régime. Le monocylindre a donc une plage utile réduite par les contraintes mécaniques et cette architecture mécanique souffre de l’inexpérience des motards. Lèger, vif , agile, coupleux, et peu coûteux en entretien, le monocylindre convient parfaitement à des motos de ville, ou à des motos calmes évoluant sur départementales.
Les bicylindres
Cette architecture est née de la séparation d’un quatre cylindres en deux. Dans l’histoire de la moto, il y eut d’abord les monocylindres, puis les quatre cylindres et ensuite les bicylindres ; ceux-ci se subdivisent en trois architectures de motorisation différentes :
Les bicylindres à plat
Cette architecture moteur ne se trouve quasiment que chez BMW. L’inconvénient des bicylindres à plat (cylindres opposés à 180°) est qu’ils engendrent un surpoids et une largeur excessive du moteur ceci étant compensé par un centre de gravité placé très bas.
Les bicylindres en V
C’est l’architecture qui est la plus usitée actuellement. Cette disposition, qui caractérisait les Harley-Davidson, se retrouve désormais sur les customs japonais, les trails – Honda Transalp par exemple –, quelques motos routières mais aussi sur des sportives telles les Ducati. Sur les Ducati, l’angle du bicylindre en V parvient à 90° et se transforme en un L mais l’architecture reste la même. Le bicylindre en V peut être mis dans un plan sagittal comme chez Moto-Guzzi ou dans un plan frontal comme chez Harley.
Les bicylindres verticaux, en ligne ou parallèle
Ces bicylindres ne sont ni plus ni moins que des quatre cylindres coupés par moitié sur le plan sagittal. Cette architecture tend à rendre le moteur plus puissant, au détriment du couple et de la souplesse du moteur.
Les trois cylindres
Les qualités du trois cylindres résident dans l’art du compromis. Cette architecture moteur est devenue la griffe de Triumph depuis son retour en 1992. Il convient de signaler que les « trois pattes » ont fait la belle histoire de la moto avec la Laverda 1000 Jota, et la fumante Kawasaki 750 H2. Les moteurs dotés de cette architecture ont un comportement proche des bicylindres de par la disponibilité du couple, mais avec l’allonge en plus. Ce sont des moteurs à fort caractère, qui sont reconnaissables à leur sonorité très caractèristique.
Les quatre cylindres
La grande qualité du quatre cylindres réside dans sa souplesse ; la plupart des modèles entre 600 et 1 000 cm³ reprennent dès le ralenti sur le dernier rapport. Si le moteur est disponible très tôt dans les tours, il apprécie les hauts régimes. Fort de son allonge le « quatre pattes » ne vit réellement qu’au delà des deux tiers du compte-tours ; en dessous de ce seuil les accélérations sont linéaires et molles. Les quatre cylindres se déclinent sous deux formes : le quatre cylindres à plat, présent sur la 600 fazer notamment et le V4, présent sur la célèbre V-max.
Les différents types de refroidissement
Le refroidissement par air
Le refroidissement par air est encore très présent, même sur de grosses motos. Pourtant ce type de refroidissement est archaïque. L’air est physiquement un isolant thermique, comment peut-il à ce titre prétendre à un quelconque refroidissement ? Une moto refroidit par air tendra à surchauffer en ville, ce qui rendra son moteur bruyant et récalcitrant. A l’inverse sur autoroute cette même moto aura de la peine à atteindre sa température optimale de fonctionnement, il s’en suivra des montées en régime peu vivaces, et un embrayage qui donnera l’impression de coller.
Le refroidissement mixte (air et huile)
Le refroidissement par air et huile est basé sur l’échange thermique entre l’air et l’huile. L’huile circule autour des organes qui chauffent, puis est refroidi via un petit radiateur par l’air extérieur. Comme l’huile baisse plus vite en température qu’elle n’y monte, ce type de refroidissement est un gage de longévité de la moto, surtout qu’elle est utilisée sur des moteurs globalement peu puissants. Cette technique est utilisée par BMW, Ducati et Suzuki.
Le refroidissement liquide
Le refroidissement liquide est quand à lui beaucoup plus efficace. Le radiateur sert de centrale de régulation thermique. L’eau étant un excellent thermostatique, cette technique permet de garder une température optimale de fonctionnement. Le seul inconvénient de cette régulation thermique, vient de son entretien. Sur les modèles hyper sport les températures internes de fonctionnement sont régulées par un échangeur eau huile en plus du refroidissement liquide.
-
Les différents types de bagages
Quelle que soit la machine, la destination de vacances et la façon d’envisager le tourisme à moto, une chose demeure comme éternelle constante : comment mettre les bagages sur une moto ? En moto, même le minimum devient vite une prise de tête qui peut réellement gâcher le plaisir du tourisme motocycliste. Quatre solutions s’offrent à vous.
Sac à dos
Dans le cas du sac à dos, aucun dispositif de transport n’est installé sur la machine puisque c’est le corps du conducteur qui supporte le bagage. La moto reste alors strictement identique à l’origine et son comportement dynamique n’est pas altéré, sauf en cas d’utilisation d’un sac à dos de trop gros litrage – type sac de trekking – de fait, il convient de limiter le volume à ± 50 ℓ.
Bagagerie arrimée
Sur une moto ce ne sont pas les points d’attache et d’ancrage qui manquent… Il suffit dès lors d’une araignée et / ou de tendeurs pour arrimer ses affaires directement sur la moto.
Bagagerie souple
Il s’agit ici de combiner sacoche de réservoir, sacoches cavalières et éventuellement un sac de selle. Homogène et cohérente, cette solution s’adapte très bien à la ligne de la moto, et sa modularité permet d’appréhender de manière optimale les divers trajets vacanciers. A noter que la pose d’un tapis de réservoir est indispensable sur les réservoirs non métalliques.
Bagagerie rigide
D’origine ou ajoutée en option, la bagagerie rigide demande la modification permanente de la moto (support Wingrack ® ou similaire). Composé de valises latérales et d’un top case, ce type de bagagerie modifie le comportement dynamique de la moto de manière significative.
Comparatif
A la station service
Sac à dos et bagagerie rigide ne nécessitent aucune manipulation. La bagagerie souple, comme la bagagerie arrimée, nécessite de défaire ses bagages pour accèder au réservoir. Une solution peu pratique qui le devient encore moins au moment d’aller payer (dans le cas d’un voyage en solo, avec paiement au guichet).
* Bagagerie rigide : 4 points
* Sac à dos : 4 points
* Bagagerie souple : 2 points
* Bagagerie arrimée : 1 point
Au restaurant
La bagagerie rigide présente la solution idéale : vous laissez vos bagages sur la moto, le verrouillage des valises et du top-case vous permettant d’être tranquille. La bagagerie souple et le sac à dos vous imposent un transport encombrant, mais pratique. La bagagerie arrimée vous impose la plupart du temps de laisser vos affaires sur la moto… avec le risque de vol inhérent !
* Bagagerie rigide : 4 points
* Sac à dos : 2 points
* Bagagerie souple : 2 points
* Bagagerie arrimée : 1 point
A l’hôtel
Le sac à dos est la solution la plus facile ; vous descendez de la moto et vous entrez dans l’hôtel les mains libres. La bagagerie souple vous permet de mettre sacoche de réservoir en bandoulière et sacoches cavalières dans une main, laissant l’autre libre pour ouvrir les portes et remplir la paperasserie de l’hôtel. La bagagerie rigide avoue ici ses limites ; avec deux valises et un top-case (puisque vous avez besoin de tous vos bagages et également afin de lutter contre le vol), deux mains ne suffisent pas… La bagagerie arrimée vous impose la fastidieuse manipulation de tout défaire et, donc de tout ré-arrimer le lendemain matin…
* Sac à dos : 4 points
* Bagagerie souple : 3 points
* Bagagerie rigide : 2 points
* Bagagerie arrimée : 1 point
Sur place
La bagagerie rigide s’avère pratique, surtout si vous disposez d’un top-case – les valises latérales étant un handicap pour circuler entre les voitures dans les bouchons estivaux. C’est le seul moyen de ne pas porter son casque durant les activités de la journée… La bagagerie souple présente l’avantage de fournir un support de carte routière, mais le port en bandoulière est moins confortable que le port stable du sac à dos. L’arrimage des affaires avoue encore une fois ses limites … de manière quotidienne.
* Bagagerie rigide : 4 points
* Sac à dos : 2 points
* Bagagerie souple : 2 points
* Bagagerie arrimée : 1 point
Sur route
Le surpoids engendré par les bagages n’entraîne pas une altération dynamique de la moto si ce poids reste près du centre de gravité de la moto et ne se trouve pas en déport de l’empattement. La bagagerie arrimée montre ici son point fort. Les bagages étant épousant les formes de la moto, il n’y a que peu d’altération du comportement dynamique de la moto. La sacoche de réservoir altère le rayon de braquage de la moto, et peu gèner la visibilité du tableau de bord. Turbulances, fatigue, risques en cas de chute sont les aléas liés au port du sac à dos. Enfin la bagagerie rigide altère considérablement le comportement dynamique de la moto, provoquant fréquemment louvoiement et guidonnage.
* Bagagerie arrimée : 3 points
* Sac à dos : 2 points
* Bagagerie souple : 2 points
* Bagagerie rigide : 1 point
Chargement
Le chargement étant lié au volume de la bagagerie et à sa rigidité, il est évident que le chargement se fera plus facilement avec une bagagerie rigide qu’avec un sac à dos… Ce n’est d’ailleurs pas pour rien que les coffres latéraux sont communément appellés valises. La bagagerie arrimée ne présentant nulle contrainte, sa modularité est gage de facilité pourvu que l’on soit réaliste dans les dimensions du paquetage. Simple et efficace la bagagerie souple présente l’inconvénient d’une structure sans forme, ce qui tend à chiffonner les vêtements et à ne pas les tenir en place. Du fait de l’unicité de l’emplacement, et de sa capacité réduite le sac à dos s’avère être le choix le moins pertinent en matière de chargement.
* Bagagerie rigide : 4 points
* Bagagerie arrimée : 3 points
* Bagagerie souple : 2 points
* Sac à dos : 1 point
Mise en place
Attention à bien verrouiller les valises et le top-case, sous peine de les voir se détacher en cours de route… Hormis ce détail, l’installation de la bagagerie rigide est idéale. L’installation simple et intuitive de la bagagerie souple s’avère être une qualité appréciable au quotidien. En théorie mettre un sac à dos devrait être simple, oui mais entre théorie et pratique il y a souvent un boulevard… Les coques de coudes du blouson gènent souvent la mise en place du sac à dos, et le réglages des sangles est à revoir à chaque fois afin de s'ajuster le plus possible au corps, et ainsi limiter la fatigue et les douleurs aux trapèzes. La bagagerie arrimée s’avère fastidieuse et longue et arrive donc dernière de notre classement.
* Bagagerie rigide : 4 points
* Bagagerie souple : 3 points
* Sac à dos : 2 points
* Bagagerie arrimée : 1 point
Budget
Avec 10 EUR, la bagagerie arrimée arrive largement en tête de notre comparatif. Un sac à dos de ± 50 ℓ coûte moins de 50 EUR dans certaines marques de magasins de sport. La bagagerie souple nécessite, quand à elle, un investissement plus lourd : tapis de réservoir(80 EUR), sacoche de réservoir(80 EUR), sacoches cavalières(120 EUR), soit un total de ± 280 EUR. Avec un prix avoisinnant les 1 000 EUR pour l’ensemble valises, top-case et support Wingrack ® ou équivalent, la bagagerie rigide s’avère la solution la plus onéreuse.
* Bagagerie arrimée : 4 points
* Sac à dos : 4 points
* Bagagerie souple : 2 points
* Bagagerie rigide : 1 point
Total de points (sur un total de 32 points attribuables possibles)
* bagagerie rigide : 24 points
* sac à dos : 21 points
* bagagerie souple : 17 points
* bagagerie arrimée : 15 points
Conclusion
Étonnemment, sac à dos et bagagerie rigide carracolent en tête de ce comparatif. Il convient toutefois d’attirer l’attention sur le réel danger – pour la colonne vertébrale – que peut représenter un sac à dos en cas de chute.
A notre avis, la solution idéale combine ces quatres types de bagageries : sacoche de réservoir, top case et sac à dos pour les vacances sur place ; la solution des bagages arrimés étant la meilleure solution pour le transport de la tente ou des duvets.
-
La vidange de la moto fait partie de l’entretien de la moto et doit être effectuée selon les préconisations constructeurs. En l’absence de celles-ci faites-la tous les 5000 à 6000 km. Cette opération est essentielle pour la bonne santé du moteur de votre moto.
De quel matériel avez vous besoin ?
D’huile neuve ; si votre « manuel du propriétaire » préconise 4 ℓ d’huile prévoyez un bidon de 5 ℓ afin de pouvoir faire les ajouts éventuels une fois la quantité constructeur versée dans le carter d’huile.
Il existe trois types d’huile : l’huile de synthèse qui est la plus chère et la plus adaptée aux moteurs des sportives, compte tenu du régime de moteur élevé. L’huile de semi-synthèse est optimale pour la majorité des autres motos tandis que l’huile minérale est plutôt destinée aux vieilles motos ou aux motos de conception ancienne.
Concernant l’indice, le premier nombre correspond au grade à froid et le second au grade à chaud. Ainsi une huile multigrade 15W50 présente les propriétés d’une huile monograde SAE 15W (winter, sous entendu démarrage à froid), et d’une huile monograde SAE 50 une fois le moteur à température (à chaud). Plus le grade est bas, plus l’huile est fluide. Plus le grade est élevé, plus l’huile est épaisse. On opte souvent pour du 10W40, qui s’avère être un bon compromis pour rouler toute l’année en ville, une huile plus visqueuse, comme la 15W50 s’avère plus adaptée à un usage routier.
Il faudra également prévoir :
* une bassine large de bonne contenance pour récupérer l’huile usagée (ou un bidon spécial vidange en vente chez Norauto)
* un entonnoir
* un filtre à huile neuf si vous comptez le changer
* un joint métallique neuf (mettre le coté non fendu contre le carter moteur)
* une clé dynamométrique pour désserrer et surtout serrer la vis de vidange
* une pince ou un tournevis (suivant le modèle) pour démonter le filtre à huile
La vidange
1. Faites chauffer votre moteur 5 min afin de rendre l’huile plus fluide, cela permettra un meilleur écoulement lors de la vidange.
2. Positionnez votre moto sur la béquille centrale ; si votre véhicule n’en dispose pas, utilisez une béquille de stand (moins de 100 EUR).
3. Moteur éteint, placez votre bassine sous la moto sous la vis de vidange.
4. Enlevez le bouchon de remplissage.
5. A l’aide de la clé de vidange, desserrez la vis de vidange en faisant attention de ne pas la laisser tomber dans la bassine. Si vous avez fait tourner le moteur durant 5 min, la température de l’huile ne présente pas de danger et vous ne risquez pas de vous brûler.
6. Patientez jusqu’à ce que toute l’huile s’écoule dans la bassine.
7. Une fois la vidange effectuée, profitez-en pour nettoyer votre vis de vidange et changer le joint.
8. Remettez la vis de vidange, d’abord manuellement sans forcer. Si la vis ne se positionne pas correctement dans le filetage, c’est que vous l’avez mal positionnée – forcer ne fera qu’altérer le filetage du carter, avec pour conséquence une perte d’étanchéité du bloc moteur. Lorsque vous avez bien repositionné le bouchon, finissez le serrage avec une clé dynamométrique, au couple préconisé par le manuel du propriétaire – environ 2 m.daN (1 m.kg = 1 m.daN = 10 Nm).
9. En principe, le serrage doit respecter un couple de serrage, que vous trouverez sur la notice d’utilisation ou dans la Revue Moto Technique spécifique à votre modèle. En effet, si vous serrez trop fort, vous pouvez abimer le filtage. Par contre si vous ne serrez pas assez, le bouchon pourrait se dévisser. Si vous préférez éviter ce désagrément, utilisez une clé dynamométrique.
Changement du filtre a huile
1. Changez le filtre à huile. Il existe deux types de filtre à huile :
* Le filtre en papier (intérieur) se situe au niveau du carter moteur. Placez la bassine sous le filtre car lorsque vous le retirez, de l’huile risque de couler. Ensuite dévissez le filtre à la main en prenant soin de récupérer les rondelles et le ressort. En principe un joint est fourni avec le filtre à huile, avant de placer le nouveau filtre, pensez à passer de l’huile dessus. Repositionnez le ressort de maintien et les rondelles sur le nouveau filtre. Puis revissez le tout.
* Le filtre en métal (exterieur) se dévisse à l’aide d’une pince à filtre. Placez votre bassine en dessous du filtre avant de le dévisser avec votre pince. Huilez le joint fourni avec le nouveau filtre puis replacez et revissez-le. Utilisez à nouveau la pince pour finir le serrage.
2. A l’aide d’un entonnoir, versez la quantité d’huile que vous avez précédemment déterminée.
3. Faites tourner le moteur.
4. Complétez avec de l’huile jusqu’à atteindre le niveau maximum grâce au hublot de contrôle (dans le cas d’une jauge, ne vissez pas le bouchon, mais posez le simplement sur le haut du pas de vis du carter d’huile).
5. Transférez l’huile usagée dans les bidons vides grâce à l’entonnoir. Apportez ensuite les bidons dans un garage qui les enverra dans un centre de traitement spécialisé pour les hydrocarbures et le liquide de frein.
Les produits miracles
Les produits miracles, type Mécacyl, qui espacent la durée inter-vidange font parler d’eux dans les magasines et sont sujets à des débats passionnés sur les forums de motards et d’automobilistes. Les résultats des études scientifiques étant contradictoires et au vu du prix de ces additifs, il nous semble infiniment plus sûr de respecter les préconisations constructeurs et de ne pas utiliser de tels produits. La même prudence s’applique aux produits « pré-vidange » qui peuvent s’avérer désastreux sur le plan de l’étanchéité moteur.
-
S'il s'avère difficile de gèrer l'usure des consommables d'une moto, tels que pneus et plaquettes, il s'avère assez facile de prévenir celle du kit chaîne. En effet, la durée de vie du kit chaîne est étroitement liée à la régularité et à la qualité de son entretien.
kit chaîne, kézako ?
Sur la moto, la transmission est un ensemble de pièces soumises à des efforts intenses et à une agression permanente des agents extérieurs. La transmission doit s'adapter aux besoins du moteur et en assumer les contraintes, tout en assurant la mobilité de ses propres pièces. Pour ce faire, hormis sur les petites cylindrées, la chaîne est équipée de joints thoriques en caoutchouc, mais le téflon est également utilisé. Ces joints jouent un rôle d'étanchéité, en gardant la graisse à l'intérieur des rouleaux afin d'offrir une lubrification permanente. Il exite différents profils communément appellés O'Ring, X'Ring et XW'Ring. L'intérêt des deux derniers réside en une diminution des frictions destinée à minimiser les pertes de puissance ; une chaîne absordant environ 10 % de la puissance moteur.
Les facteurs d'usures du kit chaîne
Le manque d'entretien est la première cause d'usure du kit chaîne. Il convient de savoir qu'une chaîne sous carter étanche a une durée de vie voisinne de ± 50 000 km – l'usure survenant souvant du fait de l'absence d'entretien et donc de lubrification –, ce qui démontre bien que la pluie et la poussière sont des facteurs aggravants. De fortes accélérations, une conduite sur le couple, l'architecture moteur, ainsi que la puissance jouent également un rôle non négligeable sur la durée de vie du kit chaîne. Une chaîne trop tendue travaille mal et entraîne une usure des roulements de roue, voire plus conséquemment ceux de la boîte de vitesse. A l'inverse, une chaîne trop détendue fonctionnera de manière non linéaire et transmettra des chocs à la transmission – rendant le passage des vitesses saccadé –, elle viendra également taper sur les pièces statiques de la moto : bras oscillant, carter moteur… Attention lors du nettoyage de la chaîne, les solvants – qu'ils soient issus du gas-oil, de l'essence, ou d'autres éthers – diminuent l'étanchéité des joints.
Comment nettoyer et dégraisser une chaîne moto ?
Il y a quelques années les mécaniciens dégraissaient les chaînes avec de l'essence normale – sous-entendez plombée et peu raffinée. La suppression du plomb dans les carburants nous incite à proscrire le nettoyage des kits chaînes à l'essence, les esthers contenus dans l'essence sans plomb (SP 95 et SP 98) finissant par attaquer les joints thoriques.
L'idéal serait de dégraisser la chaîne avec du kérozène, mais il est difficile de s'en procurer. De fait, une des alternatives les plus intéressantes est de frotter la chaîne avec un chiffon et, avec une brosse à dent dure sèche de faire de même pour les rouleaux. Une fois le gros de la graisse partie, il suffit de passer une éponge bien imbibée d'eau et de produit de liquide pour la vaisselle, qui dissout la graisse sans être agressif pour les joints.
Après ce nettoyage, l'idéal est de rouler une petite dizaine de kilomètres pour que la force centrifuge fasse sortir des rouleaux le reste d'eau et de saleté. Celà va également dans un second temps dilater les joints, et vous pourrez alors, à votre retour graisser la chaine.
Comment graisser une chaîne moto ?
Il existe quatre méthodes pour lubrifier la transmission d'un quad ou d'une moto :
Installation d'un système de lubrification permanent comme le Cameleon Oiler ®
L'installation d'un système de lubrification permanent comme le Cameleon Oiler ® – ou le Scott Oiler ® – permet une lubrification optimale pour le kit chaîne, c'est de loin la meilleure solution pour entretenir son kit chaîne. Le réservoir est rempli d'huile de transmission, d'huile fluide de tronçonneuse ou d'une huile moteur SAE 90 à 240. La durée de vie du kit chaîne est largement prolongée avec ces systèmes – exemple d'une Honda VFR 800 dont le kit chaîne a 58 000 km et est à l'état neuf, avec pour seul entretien un réglage à 13 000 km…
Bien que couteux à l'achat ces produits s'avèrent rapidement amortis, et l'entretien de la moto en est grandement facilité. Cameleon Oiler™ a été testé, approuvé et adopté par la rédaction de Moto-monde.com.
L'huile de tronçonneuse étant une huile filante de faible qualité, nous testons actuellement l'huile proposée par le fabriquant du Cameleon Oiler ®, Cameleon Chain Oil ®, nous vous tiendrons au courant de sa valeur ajoutée par rapport aux huiles filantes de tronçonneuses.
Cameleon Oiler
Cameleon Oiler ®
Application de graisse en pot ou en tube à l'aide d'une brosse à dents
L'application de graisse en pot ou en tube à l'aide d'une brosse à dents est un bon compromis et présente l'avantage d'offrir un graissage complet et soigné, tout en évitant le gaspillage de produit. Cette méthode permet de bien graisser les joints, car ce sont eux qui ont le plus besoin d'être lubrifiés. C'est également la meilleure méthode pour les motos équipées d'un carter de chaîne secondaire étanche.
Les professionnels de la moto utilisent la graisse Molykote BR 2 plus au bisulfure de molybdène, étalée à la brosse à dents, qui est la meilleure graisse épaisse sur le marché. La graisse Castrol LMX, largement diffusée en grandes-surfaces, peut également être utilisée.
Les graisses crémeuses de type Afam Powerlub et France Équipement Chain Lub se révèlent être des produits de bonne facture, mais leur prix est supérieur aux produits précédemment cités.
Bien que la graisse ne représente pas autant de risque de dispersion sur le pneu faites attention à ne pas surgraisser votre kit-chaîne, le point faible de la graisse en tube ou en pot restant l'encrassement rapide qu'elle provoque sur le kit chaîne (chaîne, couronne, pignon, protège chaîne…) et l'usure inhérente, si l'on ne procède pas à un nettoyage rigoureux avant chaque regraissage.
L'application de la graisse sur la chaîne doit se faire après un parcours ayant permis de dilater les joints de par l'action de la chaleur. Une fois la chaîne chaude et dilatée, la graisse pénètre mieux dans les maillons et permets également une évaporation plus rapide des solvants. Ensuite il faut laisser reposer la graisse une dizaine d'heures pour assurer sa résistance à la force centrifuge.
Application de d'huile de tronçonneuse à la brosse à dents
L'application d'huile de tronçonneuse à la brosse à dents est une variante de l'application de la graisse en pot ou en tube. Du fait que l'huile de tronçonneuse est une huile filante, elle se glisse parfaitement entre les joints des rouleaux et permet une lubrification de bonne qualité. Son dosage est néammoins fastidieux, et – bien que plus efficace que la lubrification par graisse en pot ou en tube –, elle s'adresse plus à des motards aimant mettre la main dans le cambouis.
Attention à la surlubrification, la force centrifuge entrainera l'excédent d'huile sur la jante voir le pneu arrière, rendant votre première sortie potentiellement dangereuse.
Vaporisation de graisse à l'aide d'une bombe de graisse spéciale
La solution la moins efficace des quatre proposés dans cet article. Elle a pour elle sa praticité lors des voyages, mais s'avère rapidement onéreuse. La durée de lubrification de telles bombes est faible et il convient de regraisser la chaîne secondaire tous les 300 km après avoir roulé, et également après chaque roulage sous la pluie.
La vaporisation de graisse à l'aide d'une bombe de graisse spéciale utilise une graisse fluide, qu'il faut pulvériser à l'intérieur de la chaîne, la graisse se centrifugeant d'elle même sous l'action de la roue arrière. Il va de soi que la roue arrière est, durant cette opération, tournée à la main et non en ayant enclenché la première – combien de motards ce sont ainsi vu broyer les doigts par la chaîne et la couronne ?!
En bref…
Nous vous conseillons donc l'utilisation d'un système de lubrification permanent. Si vous ne souhaitez pas opter pour l'un de ses systèmes, le second meilleur choix se porte sur la lubrification au pinceau. La bombe de graisse, quant à elle, ne devrait être utilisée qu'occasionnellement.
Vérifications et tension
La tension d'une chaîne se vérifie tous les 1 000 km environ. Il convient également de vérifier son degré d'usure, pour ce faire, saisir la chaîne à deux doigts sur l'arrière de la couronne et tirer pour essayer de la décoller. Si vous parvenez à sortir la chaîne de plus de 50 % de la denture de la couronne, c'est que le kit chaîne est usé et doit être remplacé dans les plus brefs délais. Une fois la vérification d'usure effectuée, faites faire un tour complet à la roue, et la positionner là ou la chaîne semble la plus tendue, ensuite suivez les instructions constructeur. La flèche à respecter est d'environ 2 cm entre le point haut et le point bas de la chaîne ; mesure effectuée avec un pied à coulisse à égale distance de l'axe de roue arrière et du pignon de sortie de boîte, un doigt tendant la chaîne. Vérifier que les repères des bras oscillants soient bien en face ; faire un contre-controle en se mettant derrière la roue et en faisant tourner celle-ci. L'axe de roue arrière est à serrer au couple de 10 m.kg (1 m.kg = 1 m.daN = 10 Nm).
Remplacement
Il est nécessaire de changer pignon de sortie de boîte, couronne et chaîne en même temps, sinon la pièce neuve serait roder en tenant compte des défauts des autres pièces, qui elles mêmes sont en partie usées. La conséquence première serait une mauvaise transmission de la puissance, la seconde conséquence serait l'usure voire la casse des dents de couronne ou de pignon. Enfin n'hésitez pas à investir 20 EUR de plus et privilégiez le profil XW'Ring qui est le modèle le plus renforcé, et donc le plus durable dans le temps.
Les risques en cas de négligence
Sans lubrifiant (graisse ou huile) les rouleaux s'usent, se déforment, s'oxydent et forment des points durs. La mobilité inter maillons se retrouve altérée et la chaîne devient rigide, créant ainsi des surtensions et des vrillages. Il résulte un risque de bris de chaîne accru, mais aussi une usure prématurée de pignon de sortie de boite et de la couronne de roue arrière. En cas de rupture de chaîne, celle ci s'enroule fréquemment autour de la roue, entrainant un blocage de cette dernière, ou autour du pignon de boîte cassant au passage le carter moteur, les dégâts sont alors très conséquents.
Les autres reponses a ce topic sur l'ancien forum en cliquant ici
-
Réaliser des économies de carburant substantielles
Si l’on met deux personnes différentes sur la même moto dans les mêmes conditions, elles ne réaliseront pas la même consommation de carburants du fait d’une conduite différente. A conduite similaire divers facteurs ont également une incidence sur la consommation de votre véhicule : conduite de nuit, pression pneumatique, duo…
Accélération
Évitez les grosses accélérations. Sur une 1 000 cm³ la consommation instantanée en cas de grosse accélération avoisinne les 90 l / 100 km ! Il est souvent inutile de dépasser 40 % du régime moteur lors d’un trajet (hors dépassement), soit ± 5 000 tr / min pour une moto ayant une zone rouge à 12 000 tr / min.
Carburation
Si votre moto est équipée de carburateur(s), réglez le ralenti au minimum supporté par votre moteur, en effet, au bout de 15 km le ralenti tend à monter de 100 à 200 tr / min. Pensez donc à prévoir cette hausse lors du réglage initial. Évitez également de rouler au starter.
Électricité
Ne multipliez pas les accessoires électriques, qui sont de grands consommateurs d’énergie et donc de carburants.
Entretien
Changez le filtre à air et le filtre à huile à chaque vidange. Privilégiez une huile adaptée au type de parcours que vous faites, et changez là 1 000 km avant le chiffre préconisé par le constructeur en cas d’usage exclusivement urbain. Sur parcours routier, privilégiez de l’huile moteur ayant un second grade élevé, comme la 15W50 par exemple. En ville optez pour une huile plus fluide, comme de la 10W40.
Nettoyez le filtre à air dès 6 000 km en cas d’usage mixte, 1 000 km plus tôt en usage citadin.
Vérifiez régulièrement que vos disques de freins ne soient pas mordus, rayés et que les plaquettes s’usent bien de manière uniforme ; un piston de frein frottant légèrement sur le disque peut engendrer une surconsommation de l’ordre de 15 %.
Hiver
Contrairement à une idée reçu, une moto ne consomme pas plus en hiver qu’en été dans le cas d’une conduite identique (donc sans starter). En effet, sur un moteur essence, le rapport air / essence est toujours maintenu assez proche du rapport stœchiométrique, qui n’est pas influencé par la température ambiante.
Pneumatiques
Partant du principe qu’un pneu sous-gonflé entraine une surconsommation de carburant, dûe à une surface de frottement plus grande entre la route et la gomme, il semble intéressant de surgonfler ses pneumatiques. Une pression constructeur majorée de 0,2 à 0,5 bars à froid diminue la bande de roulement, augmentant ainsi les performances à régime moteur égal, d’où une économie de carburant.
Virage
Utilisez le frein arrière plutot que de couper les gaz pour amorcer une courbe. En effet cela évite de réaccélérer en sortie de courbe et économise donc le carburant, tout en offrant un meilleur feeling et une meilleure trajectoire.
Conclusion
Pour consommer moins, il convient d’avoir une moto présentant le moins de contraintes mécaniques et donc en parfait état. Il convient également de ne pas se comporter en « Joe Bar » atomisant les mouches sur son passage. Une conduite coulée est de mise et permet de réaliser des consommations inférieures à 4 l / 100 km pour une 600 cm³ en usage routier.
-
Tout motard se pose la question de la matière au moment de choisir son équipement. S’il est difficile d’apporter une réponse tranchée, il est au moins possible de délivrer quelques conseils de bon sens.
Avant de se décider pour l’une ou l’autre matière, il faut s’interroger sur sa façon de pratiquer la moto. De longs trajets à allure soutenue placent la sécurité au centre des débats, ce qui n’est pas forcément le cas pour de courtes distances en ville. Un roadster impose de mieux se protéger du froid qu’un scooter ou une grosse GT. Et comme l’équipement 100 % efficace reste à inventer, le consomotard doit faire des concessions.
Sécurité Aussi élaborés soient-ils, les textiles résistent moins à l’abrasion. Au contact du bitume, le textile se déchire et s’effrite quand le cuir ne fait que se râper. Cette supériorité ne vaut toutefois que si son épaisseur est suffisante et qu’il possède des coutures de qualité (fréquent talon d’Achille des vestes et pantalons). Si vous optez pour le textile, choisissez un modèle à coques de protection (coude, épaule, dos) conformes aux norme européennes (EN 1621-1 et EN 1621-2).
Adaptation au climat Les défenseurs du textile mettent en avant sa meilleure aptitude à contrer le froid et la pluie. Ils ont plutôt raison. Les inserts techniques (par exemple Wind stopper pour le vent, Gore-Tex pour l’eau, Thinsulate pour le froid) sont en effet efficaces au point de rendre quasi désuet l’achat d’un équipement de pluie.
La conception mille-feuille des textiles permet aussi de les porter en toute saison selon que l’on ôte ou garde la doublure thermique. Le cuir oppose un rempart moins efficace aux éléments. Même avec une doublure alu, il est difficile de ne pas ressentir, au fil des bornes, la morsure du froid.
Recouverts d’une couche de polyuréthane, ils résistent aujourd’hui mieux aux averses mais également aux UV, aux griffures et à la pollution.
Esthétique Le cuir présente un look plus typé moto qui peut gêner ceux qui doivent se conformer à un code vestimentaire au travail. Ils opteront donc plutôt pour du textile. Sa souplesse laisse plus de liberté aux stylistes pour concevoir des modèles passe-partout.
Cette souplesse et la coupe ample permettent aussi de porter un costume en dessous sans trop le froisser. Confort La nature du matériau rend le cuir moins souple. À protection égale, il est aussi bien plus lourd. On peut tenter un parallèle avec les bottes d’un côté et les chaussures de stunt de l’autre…
Entretien Le cuir a contre lui de ne pas passer en machine à laver. Son entretien demande de l’huile de coude même si la présence d’une couche de polyuréthane limite le graissage aux seules coutures.
Certains textiles acceptent le passage en machine sous réserve de respecter à la lettre les consignes d’entretien. Il faudra, le plus souvent, éviter l’adoucissant. En cas de doute, consulter le site www.cofreet.com.
Longévité/Coût D’une manière générale, un équipement cuir coûte plus cher qu’un synthétique à l’achat. Mais moins sur le long terme. Non seulement un cuir vieillit mieux, résiste à la chute et peut encore au besoin être réparé par de nombreux artisans quand la majorité des textiles finissent à la poubelle après une glissade.
-
La conduite d'une moto implique obligatoirement la souscription d'un contrat d'assurance spécifique quelque soit le modèle choisi (basique, routière, custom, trail, roadster, sportive). Cette assurance est au minimum au tiers (Article L211-1 du code des assurances) afin d'indemniser les dommages causés aux tiers en cas d'accident. L'absence d'assurance moto est puni d'une amende de 3750 €, d'une suspension du permis de conduire jusqu'à 5 ans, et d'une immobilisation et/ou une confiscation du véhicule. Comme l'assurance auto, l'assurance moto est soumise au principe du système de Bonus/malus.
Une multitude de contrats
Les contrats d'assurance moto sont très divers. Les clauses obligatoires mais surtout facultatives peuvent varier d'un extrême à l'autre en fonction des compagnies d'assurance. Cette diversité s'explique notamment en raison du grand nombre de modèles de motos de puissance très divers, mais aussi du gros risque de vol des engins (près de 100.000 motos et scooters sont volés chaque année en France). Face au vol, certains assureurs obligent le motard à faire graver sa moto pour l'assurer. La plupart demande également que le motard apporte la preuve qu'il dispose d'un antivol homologué. Certains courtiers plus stricts encore obligent le garage de nuit dans un parking fermé... Si les obligations demandées par l'assureur ne sont pas respectées il peut refuser toute indemnisation en cas de sinistre.
Selon le contrat souscrit, la moto peut ou non être conduite par un autre conducteur. Le nombre d'années de permis pèse généralement beaucoup sur le prix final. Les motards jeunes conducteurs sont généralement fortement pénalisés financièrement lorsqu'ils optent pour une moto de type sportive à forte puissance.
Attention aux fausses déclarations !
Une fausse déclaration lors de la souscription de son contrat d'assurance peut être lourde de conséquence. L’assureur peut en effet prouver qu’il y a eu tromperie volontaire et annuler le contrat d'assurance sans aucun remboursement (article L113-8 du Code des Assurances). Sont considérées comme fausses déclarations l'utilisation non conforme à l'usage déclaré d'une moto, l'usage d'une moto débridée, la non déclaration du lieu d'usage habituel de la moto, la non déclaration de l'usage à titre professionnel de la moto et notamment le transport de passagers à titre onéreux. Si un accident survient, l'assureur doit apporter la preuve de la fausse déclaration pour annuler le contrat. Au besoin pour les motos modifiées, il peut faire intervenir un expert qui épluchera toutes les pièces mécaniques de l'engin. Le recours à une expertise est rare mais elle est possible. Mieux vaut donc rester vigilant en cas d'achat de motos customisées.
Le saviez-vous ?
Si les compagnies d'assurance classiques refusent de vous assurer, il est possible de faire appel au BCT (Bureau Central de Tarification des assurances) qui fixera le montant de la prime et obligera votre compagnie d'assurance régulière à vous assurer. [/b]
Comment bien choisir son assurance moto ?
Vous venez d’acheter la moto de vos rêves… mais vous n’avez pas encore trouvé quelle serait la meilleure assurance moto pour votre petit bijou !
1. Faire le bilan de vos besoins
Avant de souscrire à une assurance, faites un bilan détaillé de vos besoins en matière d’assurance moto. Quelle est la valeur de votre moto ? Préférez-vous être assuré « au tiers » ou « tous risques » ? Souhaitez-vous assurer également vos accessoires de moto ? Quelles sont les montants des franchises ?
En ayant clairement défini au préalable vos besoins et vos attentes, il vous sera alors plus facile de choisir votre assurance moto.
2. Quelle formule choisir ?
Il existe trois types de formule d’assurance possible. La première appelée « au tiers » ou « responsabilité civile » est de toute façon obligatoire. Elle garantit l’indemnisation des dommages corporels et matériels causés à des tiers. Mais attention si vous décidez de souscrire uniquement à cette assurance, sachez qu’elle ne garantit pas le conducteur de la moto ni les dommages causés au véhicule si ce dernier est responsable du sinistre. Toutefois, si votre moto n’a pas beaucoup de valeur, préférez l’assurance « au tiers ». La deuxième formule est une assurance intermédiaire. Elle comprend la responsabilité civile et le remboursement de votre véhicule en cas de vol ou d’incendie. La troisième formule correspond à l’assurance tous risques. Les termes de ce contrat reprennent toutes les garanties évoquées ci-dessus ainsi que les dommages corporels et matériels qu’autrui et vous-même aurez subis même si vous êtes responsable de l’accident. Dans la formule « tous risques », vous pouvez en plus souscrire à des garanties optionnelles comme celles notamment qui vous protègent en cas de vol d’objets ou celle appelée Garantie Accessoires de sécurité afin de couvrir vos gants de moto, votre casque.
Un conseil : inutile d’être trop prévoyant et de souscrire à toutes les garanties proposées par les compagnies d’assurance si votre moto n’est pas très bien cotée à l’Argus.
3. Attention aux montants des franchises !
Bien souvent le futur assuré cherche coûte que coûte à trouver les tarifs d’assurance les moins chers du marché sans tenir compte du montant des franchises. Erreur à ne surtout pas faire ! En effet, bien souvent lorsque les tarifs sont peu élevés, ce sont les franchises qui le sont. En d’autres termes, vous aurez certainement des franchises plus élevées à payer en cas d’accident. Réfléchissez donc bien avant de signer !
-
Nettoyer son casque est essentiel pour sa longévité. Soumis aux éléments extérieurs, aux insectes et à la pollution (c’est encore plus sensible pour ceux qui circulent beaucoup dans les grandes agglomérations), le casque se salit très vite.
Je vois souvent des motards manipuler leur casque un peu n’importe comment, un peu comme si c’était l’équivalent du sac à mains pour les filles: on le fourre n’importe où, dans n’importe quel sens, sans réfléchir au fait qu’un casque ramasse toutes les poussières, l’humidité, les corps gras, les particules, etc.
Que ce soit à l’extérieur ou à l’intérieur du casque, les saletés s’accumulent et doivent être nettoyées.
Sur l’extérieur
Le mieux et le plus simple est de laver l’extérieur du casque à l’eau savonneuse.
On veillera à appliquer des savons doux avec des chiffons non abrasifs pour épargner la peinture et le vernis, ainsi que l’écran…
Les vapeurs qui se dégagent des produits pétroliers peuvent faire se décoller le polystyrène du calotin. Tenez le casque loin des solvants et ne le laissez pas sur l’évent du réservoir d’essence.
Collé à l’intérieur de la coque, le polystyrène absorbe les chocs en se comprimant. Il est cependant assez facile d’y faire des marques avec un objet aux arêtes aigües, comme un rétroviseur, certains dossiers et “sissy bar”, et de réduire ainsi son efficacité.
Évitez donc de le déposer sur ces objets. Accrochez-le par la jugulaire à un crochet de selle, mettez-le sur le rétroviseur, posez-le entre les demi-guidons (mais pas sur le réservoir, il pourrait glisser) ou posez-le par terre (sur vos gants).
Pour garder propre la calotte extérieure, utilisez du lustreur (et non du polish, ce dernier est trop abrasif) comme le lustreur Abel Auto “Haute Protection” ou le GS27.
Dernier tuyau, rangez votre casque dans sa housse le plus souvent possible, elle lui évitera coups, rayures, poussières… Par contre, laissez l’écran légèrement ouvert, cela évitera de laisser le joint d’étanchéité comprimé, il gardera mieux sa souplesse et son efficacité.
Pour l’intérieur
Il est utile de laver régulièrement les mousses, qui sont souvent détachables, car elles sont mises a rude épreuve, entre la transpiration, le contact avec les cheveux et la pollution extérieure.
Nettoyez les traces laissées par la transpiration et la poussière sur les mousses de votre casque, employez un chiffon doux imbibé d’eau et du vrai savon de Marseille que vous ferez mousser sans oublier de rincer à grande eau (sans assouplissant). Les bombes de mousse en aérosol “spécial casque de moto” coûtent cher et ne nettoient pas aussi bien qu’un bon lavage au savon en profondeur.
Pour aider à sécher plus vite et éviter l’odeur de chien mouillé, il est possible d’utiliser un sèche-cheveux, mais pas de trop près. Chauffer trop fort le calotin peut provoquer son durcissement et diminuer sa capacité protectrice.
Si les mousses intérieures s’enlèvent, suivez les instructions de lavage du fabricant du casque. A défaut, employez du “Génie sans frotter” en rinçant bien et laissez sécher sur une serviette-éponge.
Pour les ouvertures, aérations, ventilations, utilisez un coton-tige, humidifié pour mieux accrocher.
Pour désodoriser ou absorber les odeurs, vous pouvez placer un chiffon antistatique (parfumé ou pas) vendu pour les sécheuses.
Si vous transpirez beaucoup, il existe des désinfectants pour casques ou les désodorisants anti-acariens pour chaussures de sport.
Certains motocyclistes aiment porter une cagoule même en été pour protéger le cou de l’irritation de la jugulaire, ou pour n’avoir qu’à laver la cagoule plutôt que l’intérieur du casque. L’été, la cagoule régule aussi la chaleur, à condition bien sûr qu’elle soit dans une matière respirante…
Un dernier truc, évitez de laisser vos gants dans le casque, les poussières ramassées par les gants pourraient rayer l’intérieur de l’écran et salir les mousses.
Pour l’écran
Si vous utilisez votre moto régulièrement, vous êtes soumis à des conditions météorologiques très variables. Été comme hiver, votre casque devra répondre à un cahier des charges parfois contradictoire. Il devra en effet laisser circuler de l’air pour rafraîchir en été et vous protéger du froid en hiver tout en assurant une circulation de l’air pour limiter la buée.
Certains casques possèdent d’origine des écrans traités anti-buée. Il est nécessaire de les nettoyer avec soin (à l’eau) pour conserver l’efficacité du traitement. Evitez les produits à vitres, souvent avec alcool et donc agressifs.
À défaut, vous pouvez fixer un protège-nez optionnel qui déviera vers le bas le flux de votre respiration.
Reste également la solution du “pinlock”, un second écran muni de joints qui se place à l’intérieur de l’écran.
Pour conserver à l’écran toutes ses qualités optiques, le nettoyer avec des produits non agressifs. De l’eau tiède, un chiffon doux et un nettoyant gras, genre liquide vaisselle ou savon liquide glycériné, feront très bien l’affaire.
Il s’agit d’éviter les rayures. En cas de massacre de moucherons, mouillez le plus tôt possible pour éviter que les cadavres durcissent et ne viennent rayer l’écran quand vous frotterez. Si vous ne pouvez enlever les moustiques assez tôt, déposez du papier journal humide ou un chiffon détrempé sur l’écran pour les faire ramollir.
Utiliser un chiffon antistatique pour CD, un mouchoir non-tissé pour lunettes (gratuit chez les opticiens) ou une lingette pour nettoyage de verres de lunettes.
Pour conserver l’étanchéité de l’écran, il est souhaitable de lubrifier régulièrement (mais une fois par an suffit) les joints avec un peu de silicone pour éviter qu’ils ne sèchent.
Mon casque me laisse une rougeur sur le front
Plusieurs causes : soit le casque est trop petit, soit il n’est pas adapté à la forme de votre tête, soit vous subissez une forte pression frontale de l’air (parce que vous roulez vite et/ou que votre moto ne protège pas votre tête du flux d’air, sur un roadster par exemple).
Dans ce dernier cas, et si votre casque est trop grand, il n’appuie pas de façon homogène, le poids et la pression de l’air ne sont plus répartis sur l’ensemble de la boite crânienne. Le casque va se décaler vers l’arrière et appuyer sur la zone frontale.
Plusieurs solutions:
- essayer une autre marque ou un autre modèle mieux adapté à votre forme de crâne ;
- intercaler une épaisseur souple entre la mousse du casque et la peau de votre front.
Cela peut être un foulard, un bonnet fin, une cagoule, un bandana…
Par ailleurs, cette épaisseur supplémentaire empêchera probablement votre casque de “flotter”.
Il y a de petites choses pas mal dans la gamme Tucano Urbano, avec des bonnets sans couture: voir la partie “Accessoires” et les modèles Nick et Zac.
C’est vendu en France dans les magasin pour motardes.
Voir aussi les bonnets anti-transpiration de moto-cross, chez EVS par exemple, en Lycra micro-aéré avec un bandeau élastique anti-transpiration.
Quand changer de casque ?
On vous a sans doute appris qu’il fallait changer de casque tous les cinq ans.
C’était plus ou moins vrai, avant… il y a dix ou vingt ans, au temps où les casques étaient fabriqués en plastique, ou plus précisément en ABS injecté.
Ce matériau économique - dont l’acronyme est plus facile à retenir que le nom complet (acrylinitro-butadiène-styrène, un dérivé des copolymères de styrène pour les curieux) - a pour avantage de bien dissiper l’énergie d’un choc… et pour pas cher !
Il était logique d’en faire, en dehors des poubelles et des flancs de carénage, des coques de casques.
Sauf qu’on s’est aperçu que l’exposition aux rayons ultraviolets (UV) du soleil entraînait une importante perte de la qualité d’absorption d’énergie. Les coques ABS devenaient cassantes et ne protégeaient plus.
L’UTAC, l’organisme responsable des normes techniques pour l’industrie de l’automobile et du cycle, a estimé que cinq ans d’utilisation régulière équivalaient à quelques semaines d’exposition permanente aux UV, et voilà…
Accessoirement, cela créait un intéressant marché de renouvellement pour les fabricants de casques.
Aujourd’hui, les matériaux utilisés pour les casques modernes (polycarbonates, fibre de verre, matériaux composutes à base de kevlar ou de carbone) et leurs vernis portent cette fréquence de remplacement à huit, voire dix ans.
Par ailleurs, les vernis utilisés pour recouvrir la peinture du casque possèdent la capacité de renvoyer la majeure partie des rayons UV.
Inutile donc de balancer votre beau casque qui n’a jamais chuté au bout de cinq ans jour pour jour !
Par contre, le casque doit impérativement être changé en cas d’accident, même s’il n’a subi qu’un choc léger.
Les compagnies d’assurance commencent à rembourser les casques accidentés valeur à neuf, posez la question à la vôtre.
En cas de chute du casque
Là aussi, faut arrêter de psychoter !
Les casque modernes sont faits pour encaisser des chocs bien plus importants que celui d’une chute à vide du haut d’un mètre (la hauteur maximale d’une selle ou d’un guidon de moto) sur un sol plus ou moins dur.
Pour les tests de choc de la norme européenne ECE-2205, le casque (avec une tête artificielle à l’intérieur) est projeté d’une hauteur de trois mètres, d’abord sur une enclume plate en bon acier, puis sur une autre cornière (simulant une bordure d’un trottoir) à une vitesse de 7,5 m/s (soit 27 km/h) sur tous les points d’impact, sauf le menton qui, lui, percute à 5,5 m/s (19,8 km/h).
Et le tout avec le casque gelé à -20°C pour le rendre plus cassant…
S’il est tombé de moins d’un mètre de haut sans que la tête soit à l’intérieur, même sur du goudron, la coque et le calottin n’ont pas été endommagés, le casque reste protecteur en cas de choc.
En cas de doute, l’apporter à un professionnel qui pourra, moyennant finance, le faire expertiser.
Cela n’en vaut le coût que pour des casques haut de gamme.
Un détail à ce sujet: si vous devez changer votre casque à cause d’une chute malencontreuse, sachez qu’il est dans la plupart des cas couvert par votre assurance multirisques habitation, comme vos autres vêtements ou biens ménagers.
Evidemment, vous paierez une franchise et il faudra déduire la vétusté. Mais pour un casque récent et très cher, cela peut valoir la peine de récupérer 200 ou 300 euros…
Pour les petites réparations
Pour réduire les petites rayures, on peut utiliser un polish: le “Helmet Polish” de Bel Ray ou le “métal polish” de GS27.
Les éclats dans la peinture peuvent être réparés avec un stylo à retouches pour carrosserie ou spécial pour casques (Shoei et Arai en vendent). Ou alors un feutre indélébile.
Si vous vous en sentez la capacité, vous pouvez faire une petite retouche de peinture.
Si la couche de peinture n’est pas entamée, il suffit de passer du vernis.
Si le choc a entamé la peinture, il faudra appliquer de la peinture et du vernis.
Par précaution, il est préférable de mettre un peu d’apprêt en bombe avant la peinture/vernis, pour que les solvants n’altèrent pas la calotte du casque.
Penser à délimiter la zone de réparation au ruban de masquage.
Pour la peinture, il existe chez Pébéo une gamme de peintures céramiques très résistantes, à froid. Trouvables dans les magasins de loisirs créatifs.
Certaines peintures sont à l’eau, d’autres au solvant white spirit (il faut alors passer une sous-couche de peinture à l’eau pour ne pas abîmer la calotte du casque).
Il est préférable de diluer la peinture à retouche, car elle est souvent trop épaisse et sèche trop vite.
Bon plan : dans les grandes parfumeries, il y a pratiquement toutes les nuances de couleurs en vernis à ongles (toujours après apprêt).
Attention, cela ne veut pas dire qu’il est autorisé de peindre son casque soi-même !!!
Il faut toujours éviter de peindre soi-même un casque de moto.
Certaines peintures contiennent des substances (solvants) susceptibles d’attaquer la coque et/ou le calottin (surtout sur des fibres plastiques type polycarbonates), et donc de diminuer la résistance du casque en cas de choc.
D’autres peintures, ou parfois les mêmes, contiennent du plomb, un métal lourd qui va rendre totalement impossible la réalisation d’imageries médicales de la tête en cas d’accident. Le plomb est interdit dans les peintures pour bâtiment, mais il subsiste dans certaines peintures spécialisées.
En effet, lors d’un accident de moto, surtout en cas de choc à la tête, il est déconseillé de retirer le casque. Les secouristes ont pour consigne de le laisser tant qu’ils ne sont pas certains que la tête n’a pas touché. Si le motard a perdu conscience, ne serait-ce que quelques secondes, il faut absolument laisser le casque en place.
Afin de déterminer les éventuelles lésions crâniennes et intra-crâniennes, les médecins vont devoir pratiquer des radios du crâne au moyen de différentes méthodes, notamment des rayons X et de l’IRM (imagerie par résonance magnétique).
Or toute surface couverte de plomb devient imperméable aux rayons X.
Pire encore, dans le scanner de l’IRM, qui crée un important champ magnétique (comme un gros aimant), le plomb va être attiré jusqu’à être arraché de la peinture et va venir endommager le scanner.
Il faut n’employer que des peintures spécifiques pour casques moto, sans solvants et sans plomb.
Autant laisser faire un professionnel.
-
un wheeling c'est beau quand il est bien fait , aussi pour épater la galerie , mais encore faut-il savoir que pour faire une belle roue arrière, on utilise le couple et la puissance du moteur en faisant parfois souffrir l'embrayage . certes , ses disques garnis ne coutent pas cher , mais le noix et la cloche beaucoup plus . le crabot du rapport de vitesse se marque hypotéquant ainsi son avenir . mais surtout , cette manoeuvre est risquée , avec le niveau d'huile au minimum . en effet , toute l'huile refluant à l'arriere du moteur lorsque la moto se dresse , la pompe à huile peut se désamorcer sur certains moteurs , et pas des moindres . le moteur tourne à pleine puissance SANS la préssion d'huile ; les coussinets de bielles fondent ( d'où l'expression : couler une bielle ) . les motos utilisées pour faire du stunt ont souvent reçu du professionnel un cloisonnement du carter inferieur d'huile pour exclure ce risque . d'autre part , le choc à la retombée de l'avant au sol apres un wheeling abime les roulements de colonne de direction et va même parfois feler le cadre pres de cette colonne ...
en bref : les petits malins , continuez , c'est votre pognon

-
La pression dans un pneu s'exprime en grammes, en Bar ou en Psi. Chaque semaine ou chaque fois que vous allez entreprendre un long voyage, vérifiez la pression de vos pneus. Mettez-les à bonne pression. En cas de Duo régulier, de voyage ou de circulation sur autoroute, pensez à sur gonfler légèrement (+ 0,3 Bar) les pneus froid. Rappel, un pneu froid est un pneu n'ayant pas circulé plus de 3 km à faible vitesse. Ceci évite d'aplanir la bande de roulement (les fameux pneus carrés). Un pneu "carré" engendre une perte d'adhérence à la prise d'angle et une mise sur l'angle en courbe ou en virage serré moins progressive.
A noter que l'air est par définition un mélange gazeux dont le volume varie en fonction de la température. Chaque changement de température modifie donc la pression interne de vos pneus (+ ou - 200 g). Nous vous recommandons donc de disposer facilement d'un gonfleur précis et fiable, afin de pouvoir effectuer le contrôle tranquillement chez vous. Il est également possible d'opter pour un système de surveillance de la pression d'un pneu au moyen d'un monitoring digital. La pression est alors indiquée en temps réel au guidon. Rappel : vous trouverez la bonne pression (à modifier en fonction de la charge) indiquée sur le pneu. Attention, la pression peut être indiquée en PSI. L'unité de mesure des instruments de gonflage de pneu est le Bar. Il vous faut donc la convertir en Bars ou en kilogrammes/cm2.
Conversion Bar vers Psi
1 bar = 14,5 psi
Conversion PSI vers Bar
1 psi = 0.0689 bar.
* Pneu moto froid , ne dépassez pas de plus de 200 g la pression indiquée (0,2 Bar)
* Si vous avez un passager, il faut précisément ajouter 200 g à la pression standard des pneus de votre moto
* Pneu chaud, retranchez 200 gr à la valeur lue pour avoir la pression "à froid"
Exemple, pour un pneu avant de 120/60 et un pneu arrière de 180
Les pressions usuelles recommandées :
En solo : Pression AV 2,2 - Pression AR 2,5
En duo + bagages : Pression AV 2,3 - Pression AR 2,8
Les pression usuelles constatée :
En solo : Pression AV : 2,4 - Pression AR : 2,7
En duo : Pression AV : 2,5 - Pression AR : 2,9
Pneu chaud / pneu froid
On nous parle souvent de faire chauffer les pneus à moto. Pourquoi ? Et surtout, comment faire ?
N'oubliez pas qu'un pneu froid (moto n'ayant pas roulé depuis une petite période) n'a pas une adhérence correcte, du moins optimale. En fonction de la composition chimique de sa gomme et des conditions climatiques, il chauffera plus ou moins rapidement. D'une manière générale, attendez d'avoir parcouru une dizaine de kilomètres avant de demander le maximum à votre moto. On appelle cette période la "montée en température", ou "faire chauffer la gomme". Ceci évite les glisses, les dérobades, et tous les désagrément liés à un pneu froid. Évidemment, en hiver et par 0°, autant dire que faire chauffer un pneu est un challenge.
Si vous envisagez de faire de la piste avec votre moto, il est recommandé de baisser la pression. La combinaison d'un pilotage et d'un revêtement de piste spécifiques, mettent la carcasse en contrainte et augmente la surface de gomme en contact avec la piste, ainsi que les propriétés d'adhérence. Le pneu travaille mieux, mais s'use beaucoup plus rapidement. A noter que sur piste, on ne rencontre pas les mêmes conditions que sur route, le bitume n'est pas bosselé, il n'y a pas de gravillons, ni de nids de poule, etc. Autant de facteurs qui imposent normalement de rouler avec une pression épargnant la jante en cas de choc.
Le type de pneu moto
La tenue de route de votre moto dépend énormément de la qualité et du gonflage de vos pneus. Les gommes tendres à super tendres (pneu racing voir pneu piste) sont très chargées en Silice Ils adhérent donc énormément, mais s'usent également très rapidement. Ils ne sont pas conçus pour encaisser de la ligne droite, mais conçus pour offrir une adhérence maximale sur l'angle et ce à pleine charge (accélérateur à fond). Trouver le juste compromis entre le rapport qualité/prix et l'utilisation que l'on fait de sa moto est difficile. La notion de durée est à prendre en compte. La longévité d'un pneu varie en fonction de la composition de sa gomme. Si certains peuvent parcourir plus de 25 000 km, d'autres ne dépasseront pas les 1000 km. D'une manière générale, on use plus rapidement le pneu arrière. Cela dépend du type de conduite (accélérations rapides, gestion des gaz, rétrogradages et freinages, etc.), de la puissance de la moto (plus il y en a, à transmettre, plus le pneu s'use), etc. Une conduite fluide, sur le couple et des freinages doux préserveront les gommes (accompagnement de la moto sans à-coups).
Les outils de contrôle de pneu pas cher
On trouve chez les accessoiristes des bouchons de valve disposant d'un indicateur de pression. S'ils ne sont pas toujours très précis, ces témoins visuels passent au rouge en cas de passage sous une valeur de pression fixée. Ils sont disponibles pour des pressions allant de 1,8 à 5 bars (3 maximum pour la moto). Les pressions évoluent par pas de 0,2 pair. Si votre pression optimale est impaire choisissez le modèle immédiatement supérieur. Vous trouverez également un manomètre pour contrôler la pression de vos pneus. Cette pression peut aller de 200 g à 10 bars, et doit être précise à 0,05 bar. Pour regonfler vos pneus, nous vous recommandons un mini compresseur d'appoint avec manomètre de contrôle (puissance de 1 à 10 bars).
Pneu Control un petit appareil à moins de 15 € qui non seulement améliorera votre sécurité mais vous fera aussi réaliser des économies
PneuControl est un témoin de pression de pneu. Un simple bouchon qui vous permet de vérifier d’un coup d’œil si les pneus de votre moto sont à la bonne pression. Rappelons que piloter une moto avec des pneus sous gonflés peut être non seulement dangereux mais aussi dispendieux. Dangereux car des pneus de moto sous gonflés engendrent une mauvaise tenue de route. Dispendieux car des pneus sous gonflés augmentent jusqu'à 10% la consommation en carburant et s’usent beaucoup plus vite. Le bouchon PneuControl est conçu pour s’adapter à tous types de pneus de moto et il suffit de le visser sur la valve de son pneu pour le mettre en place.
Le fonctionnement des bouchons PneuControl est mécanique. Une fois le bouchon vissé sur la valve du pneu, le mécanisme du PneuControl «mémorise» la pression de gonflage. Il s’adapte à toutes les pressions de 1,4 à 3 bars. Dès, la moindre perte de pression d'un pneu de votre moto (à partir d'une perte de 0,2 bar) déclenche le mécanisme interne, provoque une poussée du témoin de couleur rouge. Ce témoin rouge restera visible tant que la perte de pression du pneu perdura. Dés que vous remettez le pneu de votre scooter à la pression correcte le témoin de pression revient en position normal. Avec PneuControl, fini les pneus sous gonflés, l'essayer c'est l'adopter !
-
S’il neige, ça commence à devenir rock ‘n roll… Dans la mesure du possible, si vous arrivez à prévoir la chute de neige, évitez de prendre la route en deux-roues. D’abord, ça glisse un peu quand même, et surtout, la visibilité est très mauvaise. La neige vient se coller sur l’écran du casque, on ne voit rapidement plus rien, il faut l’essuyer toutes les dix secondes. Même conseils sur la visibilité que par temps de brouillard.
Rouler dans la neige fraîche et poudreuse n’est pas plus compliqué que sur une route détrempée. Essayez au maximum de suivre les traces des pneus des véhicules qui vous précèdent, tout en évitant les endroits où la neige est damée, compressée et bien souvent glacée.
Sur neige, on roule en deuxième à 10 km/h, les deux pieds sortis pour rattraper les petites glissades, sans freiner ni accélérer. Tout à l’embrayage ! Apprenez à repérer le point de patinage de l’embrayage et allez-y tout doux sur les gaz.
Cela dit, ne rêvons pas, rouler sur une couche de neige de plus de 2 ou 3 cm revient à jouer à la roulette russe avec cinq balles dans le barillet. A moins d’avoir des pneus “neige” (entourés de ficelle ou de corde, revêtus de toile spéciale ou chauffés à l’aérosol adhérent), c’est la glissade assurée. Les pneus tout-terrain ou mixtes adhèrent mieux que les pneus routiers, mais cela ne fera que retarder l’échéance.
Les troubles de santé liés au froid
L’homme est homéotherme, c’est-à-dire qu’il est muni d’un dispositif physiologique lui permettant de maintenir une température constante. A cette fin, l’organisme met en oeuvre des mécanismes dits de thermorégulation.
Le problème de l’isolation thermique, c’est de trouver l’équilibre entre l’hypothermie ou l’hyperthermie.
Afin de lutter contre l’hyperthermie (quand la température centrale tend à s’élever), trois réactions peuvent se produire :
* Vasodilatation périphérique et élévation de la température périphérique.
* Transpiration qui entraine le refroidissement de la peau par évaporation.
* Augmentation de la respiration et des échanges thermiques respiratoires.
Afin de lutter contre l’hypothermie (quand la température centrale tend à baisser), deux réactions peuvent se produire :
* Vasoconstriction périphérique, qui entraîne les engelures.
* Augmentation de la thermogénèse, c’est-à-dire augmentation de l’intensité du métabolisme qui engendre une production de chaleur supplémentaire en brûlant des calories, notamment les sucres rapides.
Les engelures sont consécutives à des troubles de la circulation qui se manifestent d’abord aux extrémités par un engourdissement. Il va sans dire que la préhension des commandes s’avère difficile. C’est dès ces premiers signes qu’il faut s’arrêter pour desserrer au maximum son équipement (ouvrir, voire quitter les bottes, si possible). La peau apparaît rougie et son réchauffement entraîne des picotements. Au stade de la gelure, les extrémités sont totalement insensibles et des cloques peuvent se former. Dans ce cas, faire appel aux secours et ne pas tenter de se réchauffer au-dessus du moteur, d’un radiateur, ni en buvant une boisson alcoolisée. Au pire, les tissus peuvent se nécroser irrémédiablement (perte de la sensibilité).
L’hypothermie se manifeste par une sensation de froid intense, des frissons puis des crampes. Elle entraîne rapidement une somnolence. Le risque est maximal lorsqu’on roule le ventre vide. Privilégier les sucres lents (pâtes, riz) aux repas du jour précédant le trajet et les en-cas sucrés à chaque arrêt. Par contre, éviter le cassoulet bien gras juste avant de partir, une digestion lourde engenre la somnolence. Il vaut mieux manger léger.
Le café a une action vasodilatatrice, il accélère donc la déperdition de chaleur, à consommer avec modération.
L’hypothermie peut mettre en danger de mort un campeur éméché (attention lors des concentres hivernales), très exposé du fait de son immobilité et de la diminution progressive de sa température interne (l’alcool n’arrange rien !). Encore une fois, ne pas tenter de réchauffer la victime façon « rasade de gnôle au coin du feu », mais alerter les secours, couvrir la victime et lui donner des aliments sucrés (en quantité raisonnable).
Voir l’article “Les gestes qui sauvent un motard“
Prévenir l’hypothermie. La consommation de poissons gras, surtout issus des mers froides (saumon, maquereau, hareng, thon), permet d’atteindre une condition physique optimale pour rouler l’hiver. Les graisses qu’ils contiennent ont la propriété de favoriser la fluidification du sang et de préserver le bon état des vaisseaux sanguins. Comme les méfaits du froid sont générés par des troubles de la circulation, l’ingestion régulière (deux à trois fois par semaine) de ces poissons est bénéfique dès les premières gelées.
Il faut impérativement éviter l’alcool ! L’alcool provoque en effet une vasodilatation périphérique, une plus grande irrigation des vaisseaux sanguins capillaires, ceux qui sont proches de la surface de l’épiderme (c’est pour ça que le visage rougit quand on a trop bu). Du coup, le sang se refroidit beaucoup plus rapidement au contact de l’air froid. L’impression de se réchauffer est factice.
Attention aux médicaments ! De nombreux traitements, notamment contre le rhume (ou rhinite, angine, bronchite, grippe…) sont incompatibles avec la conduite d’un véhicule. Il est possible de repérer ces médicaments aux effets secondaires avérés (somnolence, troubles visuels, perte de concentration…) grâce à un logo en forme de panneau triangulaire apposé sur l’emballage. Généralement, le médecin peut trouver un traitement de substitution sans effets sur la conduite, n’hésitez pas à lui demander.
Sur ce sujet, lire l’article “Rouler au mieux de sa forme“.
Pour éviter le rhume. Contrairement aux idées reçues, le rhume n’est que rarement consécutif à un refroidissement. Ce qui n’exclut pas de prendre quelques précautions contre les rigueurs hivernales car l’organisme fatigue plus vite lorsqu’il lutte contre des conditions climatiques défavorables. Il devient alors plus sensible aux intrus que sont les bactéries, microbes ou virus en tous genres.
La prise de vitamine C est utile à titre préventif. Les besoins journaliers d’un adulte sont estimés à 110 mg. Si elle ne joue aucun rôle curatif, elle peut au moins atténuer les symptômes de l’infection et éviter qu’elle ne traîne en longueur. Une alimentation adaptée permet d’assimiler la vitamine C sans avoir recours aux médicaments, d’autant qu’un excès peut occasionner des troubles digestifs (nausées, diarrhées, crampes). Les fraises, les kiwis, les agrumes (clémentines, pamplemousses, oranges et citrons) sont des mines de vitamine C, tout comme les poivrons, le persil, les brocolis ou les choux.
Dose de vitamine C pour 100 g d’aliments crus
Goyave : 250 mg
Poivron : 160 mg
Kiwi : 80 mg
Brocoli : 60 mg
Orange : 50 mg
Se soigner. Même si aucun médicament ne permet de réduire la durée d’une rhinite ou d’une angine, il est toutefois préférable de consulter son médecin aux premiers symptômes (toux, migraine, fièvre…) car la médication varie selon l’origine de l’infection (bactérienne, allergique ou virale).
Dans la moitié des cas, la prescription d’antibiotiques (nécessaire seulement contre certaines bactéries) peut être évitée au profit de simples anti-inflammatoires et/ou médicaments « classiques » (paracétamol, aspirine…). Les nombreux effets secondaires dus aux antibiotiques, particulièrement néfastes au guidon (hypovigilance, somnolence), sont ainsi évités et la résistance des souches bactériennes réduite, comme le trou de la Sécu ! Dans tous les cas, ne pas abuser des produits à inhaler pour réduire l’écoulement nasal (vasoconstricteurs locaux). S’ils peuvent paraître très efficaces et évitent de quitter le casque à chaque carrefour pour se moucher, ils ont l’inconvénient d’entraîner des rhinites chroniques en cas d’usage prolongé et répété.
Dernier élément à prendre en compte si vous multipliez les éléments chauffants, veillez à ce que l’alternateur de votre machine fournisse suffisamment de watts pour couvrir l’ensemble des besoins: phares, feu stop, clignotants, injection électronique, pompe à essence, centrale ABS, assistance au freinage, poignées chauffantes, GPS… Un gilet chauffant peut consommer jusque 100 watts à puissance maximale.
-
Améliorer sa moto contre le froid
À moins de rouler sur une moto GT avec un carénage intégral, une bulle haute, une selle et des poignées chauffantes d’origine (de série ou en option), se protéger du froid lorsque les températures deviennent négatives exige des solutions fonctionnelles, souvent au détriment de l’esthétique.
Certains motards, frileux ou exigeants sur leur confort, ajoutent une panoplie d’équipement contre la morsure du gel.
C’est l’exposition au vent relatif (provoqué par la vitesse) qui, en plus de mouiller quand il pleut, fait descendre la température de la surface des vêtements et, au bout d’un moment, celle de notre corps. Pour éviter d’être exposé au vent, on peut monter des carénages plus ou moins complets, déflecteurs ou autres bulles ou spoilers adaptables. Si l’effort s’avère limité pour une bulle haute, les travaux de mise en place peuvent être importants pour d’autres éléments de protection.
Discrètes, les poignées chauffantes (disponibles en option sur de nombreux modèles de motos routières) remplacent les poignées d’origine ou s’adaptent en se posant par-dessus. Les adaptables se présentent sous la forme d’un kit composé d’une paire de poignée, d’une commande à fixer au guidon, de fils électriques, de leurs connecteurs et d’un porte-fusible. Le raccordement est généralement assez simple à réaliser, mais il faut veiller à placer correctement le bouton de commande pour pouvoir l’actionner en roulant.
Elles nécessitent parfois quelques vérifications préalables ou aménagements électriques sur votre moto. De plus, elles ne chauffent que l’intérieur de la main et n’évitent pas les engelures par grand froid.
Moins compliqués à mettre en oeuvre, les protège-mains (ou pare-mains) présentent l’avantage de réduire ou couper l’arrivée continuelle de l’air froid sur les gants. Les trails en sont souvent équipés d’origine, mais des modèles adaptables peuvent se monter sur la plupart des machines, les formes des commandes se ressemblant généralement. Il est par ailleurs possible d’augmenter leur efficacité par des déflecteurs supplémentaires.
Plus efficaces encore, les manchons permettent de préserver les mains du froid (surtout s’ils sont combinés avec des poignées chauffantes) et de la pluie. Disgracieux, ils sont toutefois appréciés des coursiers qui, en ville, ont les doigts très souvent ouverts pour manœuvrer et n’aiment pas perdre du temps à mettre et enlever de gros gants.
Choisissez un modèle dont la taille est prévue pour vos commandes, notamment pour capuchonner le bocal de liquide de frein (et d’embrayage quand il est présent). Le manchon doit être suffisamment vaste et rigide pour qu’il ne vienne pas s’appuyer sur les leviers en prenant de la vitesse sous la pression du vent. Appliquez-vous à les lacer correctement pour qu’ils ne bougent pas et ne laissent pas d’entrée d’air.
Quelques rares modèles de motos GT proposent en option une selle chauffante, souvent couplée aux poignées chauffantes. La chaleur de la selle permet de réchauffer le sang avant qu’il ne descende dans les jambes, une solution surprenante d’efficacité, surtout avec un carénage intégral. Certains selliers et accessoiristes spécialisés la proposent en adaptable, mais c’est encore très cher.
Enfin pour les grands frileux, le tablier protecteur. Laid mais efficace, un bon tablier est doté d’armatures flexibles pour le rigidifier au niveau des jambes, avec des fibres tissées d’aluminium qui le protégeront d’un éventuel contact avec le moteur.
En roulant, le tablier protège du froid à partir de la ceinture, de la pluie mais aussi de toutes les saletés de la route et permet de porter des pantalons classiques sans les abîmer, à condition qu’il ne flotte pas et ne laisse pas remonter l’eau par en dessous. Son seul défaut, outre son aspect inesthétique, réside dans sa prise au vent. Son utilisation sera à réserver pour des déplacements à allure raisonnable.
Préparer sa moto à l’hiver
L’hiver impose non seulement une conduite adaptée, mais aussi des contraintes supplémentaires, autant pour rouler en sécurité que pour préserver notre destrier chéri de la corrosion.
* N’oubliez pas de maintenir graissés les organes mobiles. Le froid raidit les commandes, induisant une moindre précision et une possibilité de ruptures des câbles usagés (embrayage, accélérateur, compteur, frein sur les motos anciennes). Si possible, démontez les pièces avant de les lubrifier et faites-les jouer pour permettre à la graisse de pénétrer. Surveillez aussi les axes des leviers et pédales.
* Le froid fait aussi stagner l’humidité dans les cosses et connexions électriques du faisceau. Pulvérisez un produit anticorrosion (nettoyant de contacts) sur chacune.
* Graissez la chaîne plus fréquemment: celle-ci n’apprécie pas trop l’humidité et encore moins le sel d’épandage.
* De façon générale, le sel corrode très vite tous les éléments métalliques. Après chaque sortie, passez tout le bas de votre moto au jet d’arrosage avec de l’eau froide. Surtout pas d’eau chaude ! L’eau chaude dissout le sel et le fait pénétrer partout alors que l’eau froide le fait partir en gros cristaux.
* Pensez à l’état de vos pneus: profondeur de sculptures adaptée aux routes trempées (moins de 50% d’usure) et pression adéquate (sous-gonfler ne sert à rien). Attention particulièrement aux gommes hypersport qui restent dures comme du bois tant qu’elles n’ont pas atteint leur température idéale, quasi impossible à atteindre en hiver.
* Protégez vos chromes: eux non plus n’apprécient guère le sel d’épandage. Passez l’ensemble de la moto au produit protecteur “carrosserie et alliages”, sauf les freins et le pot d’échappement, évidemment !
* Attention aux freins justement, les étriers grippent facilement. Si possible, passez l’intérieur des étriers (côté pistons) au nettoyant de freins (dégraissant), à nettoyer ensuite à la souflette (demandez gentiment à un garage si vous n’avez pas de compresseur chez vous). Et évitez les plaquettes de freins “racing” hyper mordantes.
* La batterie: veillez à ce qu’elle réponde présent chaque matin. Remplacez-la avant qu’il ne soit trop tard ou investissez dans un chargeur spécial moto à charge lente. Jetez un oeil aux bornes et, si nécessaire, graissez-les. Une batterie ne supporte bien le froid que si elle chargée et en ce en permanence, il faut donc veiller à conserver un courant de charge optimal en brossant les connexions et en les protégeant contre la corrosion (paraffine ou vaseline solide).
Lire l’article “Comprendre, ménager et charger sa batterie“
* Les suspensions: réglées souple ! Un amortisseur réglé ferme réduit l’adhérence sur sol glissant. Le réglage du ressort (précontrainte) peut rester inchangé (valeur de base), mais l’hydraulique de l’amorto (détente) doit devenir plus souple.
* Un “check-up” complet auprès de votre concessionnaire habituel ne peut qu’être bénéfique.
Conseils de conduite en hiver
Augmentez votre température interne par une activité musculaire. Bougez sur la moto, une jambe après l’autre, un bras puis l’autre. Arrêtez-vous plus souvent pour vous réchauffer et bougez ! Faites des moulinets des poignets et des bras, même aux feux rouges.
Profitez de la source de chaleur principale de votre machine: son moteur. A la pause, rapprochez-en vos mains nues pour les réchauffer (sans le touher, bien sûr). Vous vous arrêtez quelques minutes ? Mettez vos gants au plus près du moteur, coincés sous le carénage ou posés sur les cylindres pour un flat-twin. Attention toutefois à ne pas les mettre avec les tubes d’échappement, cela les ferait fondre (vécu).
Pour vous réchauffer, approchez les mains d’une source de chaleur (radiateur), mais ne les mettez pas en contact direct ! Le froid anesthésie: rien de pire que de plonger des mains ou des pieds glacés dans l’eau très chaude, vous ne feriez que les brûler. Mettez-les sous l’eau tiède et augmentez très progressivement la température.
A la fin d’un long trajet hivernal, on est parfois tenté d’accélérer ou de zapper la dernière pause pour arriver plus vite. Erreur fatale ! Les derniers kilomètres sont ceux où l’on est le plus fatigué, le moins attentif et donc les plus accidentogènes.
Avant de partir pour un long trajet, informez-vous sur les conditions météo, l’état des routes, les fermetures des cols de montagne. Voir sur le site de la DDE de votre département.
Augmentez les distances de sécurité avec les véhicules vous précédant. Non seulement le sol peut être glissant, ce qui augmente la distance d’arrêt, mais en cas de neige ou de glace sur la route, des paquets de neige sale s’accumulent dans les passages de roue des voitures et des camions. D’un coup, ils se détachent et tombent juste devant vos pneus…
Autre phénomène, la pellicule de givre qui se forme sur les carrosseries ou les bâches des camions et peut se détacher sous l’effet de la vitesse ou d’un coup de vent. Vous envoyant ainsi des glaçons en pleine figure !
Se méfier également des véhicules de salage qui projettent du sel, du sable, de la neige sur les côtés et derrière eux. Ne les suivez pas de près et si vous en croisez un, ralentissez et serrez à droite, le plus loin possible.
A ce propos, ne croyez pas que suivre une saleuse vous permettra de rouler tranquillement. Non seulement, elle rendra votre moto complètement cradingue, mais le sel qu’elle dépose sur la chaussée ne fera fondre la neige ou le verglas qu’au bout de 20 minutes environ. Pire, le salage maintient une humidité constante sur le revêtement et crée même parfois une pellicule de crasse, mélange de neige fondue et de projections diverses, extrêmement glissante.
Equivalence froid/vitesse. Gardez à l’esprit que plus vite vous roulez, plus le vent relatif augmente et la température ressentie diminue. La correspondance entre la vitesse et le froid est établie par un indice de refroidissement éolien (IRE) qui vous permettra de calculer (ici sur le site d’Environnement Canada) la température réelle en fonction de votre vitesse et de la température ambiante.
Ainsi, pour une température ambiante de 10 degrés Celsius à l’arrêt sans vent, la température ressentie sur la peau nue du motard au guidon d’une moto non carénée sera déjà de -2°C à 50 km/h et de -6°C à 130 km/h. De même, un 0°C à l’arrêt se transformera en -20°C à 90 km/h et -21 degrés à 130 km/h. Par -5 en ambiant, on arrive très vite à -25 à 50 à l’heure, -28 à 90 et -29 à 130… Quand vous démarrez par -10 degrés, il fera déjà -33°C à 50 km/h et -37°C à 130 km/h !
Par temps froid et sec, aucun problème particulier ne se pose. Simplement, n’oubliez pas que l’air ambiant étant plus froid, il faudra plus de temps à votre moteur pour parvenir à sa température de fonctionnement et plus de temps aux pneus pour atteindre leur adhérence optimale.
Par temps de pluie, rien d’autre à faire que de réduire la vitesse et d’appliquer les conseils de l’article “Conduire sur route mouillée“. Rappelez-vous aussi que le fait d’être mouillé multiplie par cinq la vitesse de refroidissement de votre organisme. Pour rester au chaud, soyez parfaitement étanche ! Sinon, arrêtez-vous le temps de sécher.
Par temps de brouillard, la route est mouillée, les mêmes conseils s’appliquent. Il faudra par contre tenir compte d’une visibilité encore plus réduite, pour vous comme pour les autres. Diminuez encore plus la vitesse !
En cas de brouillasse à couper au couteau, vérifiez que votre feu de croisement est bien allumé (je sais, c’est bête à dire, mais si vous saviez ce qu’on voit des fois…), mettez les warnings si vous en avez, enclenchez bien sûr les feux anti-brouillard si votre moto en est équipée… Inutile de mettre le feu de route, le faisceau lumineux intense serait renvoyé par les goutelettes deau en suspension dans l’air et vous y verriez encore moins bien, surtout de nuit. Si possible, enfilez un gilet ou une chasuble réfléchissante, mettez un brassard à diodes (voir l’article “Rouler de nuit“).
Si vous portez des lunettes, ne commettez pas l’erreur de relever l’écran de votre casque. La condensation se formerait alors directement sur les verres de vos lunettes et vous deviendriez quasi aveugle. Entrouvrez légèrement l’écran s’il s’embue, mais ne l’ouvrez pas complètement. Essuyez fréquemment l’extérieur de l’écran avec un doigt de votre gant, sipossible doté d’une raclette. Si vous prévoyez de rouler dans le brouillard, usez et abusez des produits anti-buée ou d’un double écran “pinlock”.
Si vous passez votre temps dans la purée de pois, il va falloir envisager l’achat de la visière chauffante de Schuberth pour ses casques Concept et C2…
S’il pleut et qu’il gèle, il est probable que vous rencontrerez du verglas. Et donc de perdre l’adhérence de vos roues. Faites particulièrement attention dans les endroits venteux (ponts, gorges), les tunnels, les sous-bois où le soleil ne perce pas, les versants de montagne au nord, etc.
Si c’est en ligne droite et que la plaque de verglas n’est pas trop longue, ne freinez surtout pas, regardez loin droit devant vous, ne vous crispez pas et vous avez une chance de raccrocher le bitume. Cela m’est arrivé une fois, j’avais pris la plaque de glace (deux-trois mètres de long) pour une flaque de sel, à 100 km/h sur une quatre-voies. Cela fait tout drôle, mais je suis encore là pour vous en parler.
Si c’est dans un virage, c’est fini, vous êtes par terre, pire que du gasoil. Et toute route finit par tourner… Franchement, ne tentez pas le diable. Le verglas est le seul aléa climatique qui me dissuade d’emblée de prendre la moto.
-
Les parties les plus sensibles et les plus exposées au froid de l’hiver sont sans conteste les mains et les pieds.
Les mains sont les parties du corps les plus difficile à protéger car il faut limiter l’épaisseur des gants pour garder une bonne sensibilité des commandes.
Ici aussi, évitez de tomber dans la “paranoïa de la couche” ! Rien de pire que des mains comprimées, sans couche d’air autour des doigts pour les isoler. En cas d’engourdissement, lâcher une main du guidon et la secouer pour rétablir la circulation sanguine.
Un truc de sportifs, les pommades qui stimulent les muscles et activent la circulation sanguine, comme l’Akileïne, qui tonifie grâce à son mélange de caféine et de piment.
Par temps sec, des gants mi-saison, doublés de sous-gants de soie, peuvent faire l’affaire. S’il pleut, c’est une autre histoire et seuls des gants étanches en Gore-Tex (respirant) ou néoprène (non respirant) peuvent réellement protéger.
Une bonne solution est d’enfiler des sous-gants à l’intérieur de gants d’hiver choisis exprès une ou deux tailles trop grands, afin de laisser une couche d’air entre le sous-gant et le gant.
La solution “traditionnelle” la plus efficace par grand froid: les gants “trois doigts”, dérivés des célèbres Segura Lobster (homard). Principe simple: l’index et le majeur d’une part, l’annulaire et l’auriculaire d’autre part se réchauffent mutuellement. A mi-chemin de la moufle et du gant, ils offrent plus d’efficacité contre le froid que les gants traditionnels, mais nécessitent un temps d’adaptation. Je possède personnellement une paire de gants HG “trois doigts”, il ne m’a fallu qu’une demi-heure pour m’y habituer.
Il existe aujourd’hui des gants chauffants d’excellente qualité, chez Klan et Gerbing. Compter de 130 à 200 euros la paire.
Les pieds. Simple: des bottes très hautes doublées en Gore-Tex. Eviter les chaussures trop serrées qui limiteraient la circulation sanguine. Utiliser une paire de bottes plus grandes l’hiver pour pouvoir utiliser des chaussettes plus épaisses, qu’elles soient en laine ou en matériau technique. Les chaussettes en Coolmax ou Thinsulate pour rollers, montantes jusqu’aux genous, renforcées au tibia et à la malléole, donnent de bons résultats, celles pour l’alpinisme aussi.
Pour les adeptes des concentres hivernales dans la neige, voyez du côté des spécialistes des produits “Grand Nord” comme Sorel pour les bottes et les chaussettes Monnet Yeti, conçues pour les explorateurs polaires. Là aussi, tailler grand.
Pensez que le sang qui va venir vous réchauffer les petons passe dans les jambes. Il faut le garder au chaud tout au long de la circulation. Un caleçon long vous protégera longtemps, efficacement et pour pas cher, surtout en Damart Thermolactyl triple couche.
Si vraiment vous craignez les engelures aux pieds, essayez d’abord la paille ou le papier journal dans les bottes (à l’avant, devant les orteils), puis des chaufferettes sous la plante des pieds, et enfin les semelles chauffantes (par BMW et Gerbing).
Le visage, la tête et les oreilles. Un tiers de la déperdition de chaleur se fait par la tête, le visage et le cou. Le casque joue un rôle isolant évident: prenez un intégral bien fermé, et non un jet, si possible doté de collerettes et d’une bavette de menton. S’il fait vraiment froid, adoptez la cagoule moto ou éventuellement un “buff”, un tour de cou extensible qui peut être utilisé comme un bonnet, une cagoule, un bandeau ou un tour de cou.
Il est fondamental de se protéger le cou car c’est là que passe le sang qui vient irriguer le cerveau, il faut absolument le maintenir à 37 degrés. Evitez les grosses écharpes qui viennent vous engoncer, limiter la mobilité du cou et comprimer la gorge. Un plastron ou un tour de cou long et souple, en fibre polaire, en néoprène ou en laine, passé sous la veste en bas et bloqué par la jugulaire en haut, constitue le meilleur rempart. S’il pleut, il risque de se trouver mouillé et de vous refroidir vite fait, alors prévoyez-en un de rechange.
Les oreilles sont trés sensibles au froid sous un casque mal isolé, vous pouvez utiliser un bandeau en matériau isolant type Windtex ou Windstopper pour les protéger.
N’hésitez pas à utiliser une crème hydratante et protectrice pour les lèvres et le visage en cas de grand froid, pour éviter les gerçures.
Spécial équipements chauffants.
Un corps mal isolé se refroidit d’autant plus rapidement en l’absence de source de chaleur externe. Si votre moto n’est pas équipée de poignées ou de selle chauffantes, il existe plusieurs solutions pour créer cette source de chaleur bienfaitrice. Quand le thermomètre descend en dessous de 0°C, elle devient indispensable.
D’abord les chaufferettes. L’eau contenue dans un petit sac est saturée d’acétate de sodium en solution instable. Il suffit de plier une petite plaque en métal en suspension dans cette solution pour déstabiliser le produit et le faire cristalliser. Il se solidifie en dégageant de la chaleur pendant plusieurs dizaines de minutes. En cas de long trajet, il ne faut donc pas hésiter à en emporter plusieurs. Ces chaufferettes sont économiques (moins de trois euros pièce) et réutilisables (une centaine de fois), il suffit de les mettre à tremper dans de l’eau bouillante jusqu’à ce que la solution redevienne liquide.
Mais les chaufferettes ne peuvent pas se mettre partout, elles prennent de la place, ne peuvent pas toujours se glisser dans les gants ou les bottes, et leur chaleur ne dure pas plus d’une demi-heure. L’arme absolue du motard hivernal (et fortuné), ce sont les vêtements chauffants: gilet (sans manches) ou sous-veste, gants ou sous-gants, semelles.
Le principe est simple, un fil de résistance noyé dans la doublure du vêtement, qui va produire de la chaleur comme le filament d’une ampoule à incandescence. Confort garanti y compris par temps de gel, mais les équipements chauffants représentent tout de même quelques contraintes. D’abord une débauche de fils, de câblages et de branchements qui mettent parfois la patience à rude épreuve, surtout si on doit s’arrêter souvent et que l’on a choisi de les raccorder sur le faisceau de la moto. Ensuite, une certaine fragilité des raccords électriques et des soudures qui oblige à les manipuler avec plus de précautions que des vêtements classiques. Enfin, une ergonomie parfois perfectible, notamment au niveau des interrupteurs et des thermostats (quand il y en a).
Rien n’est parfait: si on choisit des équipements auto-alimentés par une batterie, celle-ci prend de la place, pèse son poids et ne dure jamais bien longtemps. Alors certains préfèrent connecter leurs vêtements chauffants sur une prise de bord, mais du coup, des fils traînent, il faut penser à les débrancher quand on descend de la moto, à les remettre avant de repartir… Facile quand il n’ y a qu’un gilet, plus contraignant pour des gants ou des semelles.
Même s’ils coûtent plus cher, préférez les vêtements avec thermostat ou régulateur, à deux ou trois positions. Les équipements qui ne fonctionnent qu’en mode “on/off” ont tendance à chauffer très fort, ce qui limite leur plage d’utilisation. Une position intermédiaire permet de les utiliser en mi-saison froide.
-
Il y a ceux qui rentrent leur moto au garage à l’arrivée des premiers frimas, et il y a ceux qui se refusent à abandonner leur machine sous prétexte que le thermomètre s’est mis en berne. Voici quelques conseils pour les irréductibles à qui le froid ne fait pas peur… Rouler lorsque le froid se fait mordant peut réserver des mauvaises surprises, même avec un équipement a priori adapté.
Avant de songer à transformer la moto pour se protéger du froid et de perfectionner votre conduite hivernale, il faut commencer par investir dans une tenue adéquate.
Concrètement, vous aurez besoin d’équipements d’hiver si vous roulez par moins de 5°C et pendant plus de 15 km. C’est en moyenne à partir de cette distance que le corps commence à se refroidir (variable en fonction de la vitesse et de la protection de votre véhicule).
La tenue moto d’hiver
Veste et pantalon doivent être imperméables tout en assurant une protection thermique maximale.
La veste. Choisissez de préférence une veste trois-quarts à un blouson, pour éviter les filets d’air au niveau de la taille (à condition bien sûr de disposer d’un cordon de serrage en bas). Assurez-vous qu’elle présente un bon joint thermique au niveau de la fermeture éclair centrale, avec si possible une double fermeture: ça prend du temps à fermer, mais c’est très efficace. Une veste d’hiver doit cumuler les aspects pratiques avec des poches en nombre (et étanches à l’extérieur comme à l’intérieur), une bonne étanchéité, un col montant, confortable (non irritant) et suffisamment large pour accueillir un tour de cou.
L’ajustement des manches par scratch, velcro ou fermeture éclair est préférable aux pressions, moins réglables.
L’idéal est de choisir un modèle doté d’une ou deux doublures amovibles afin de faire varier l’épaisseur en fonction des variations climatiques.
Une liaison par zip avec le pantalon, afin d’éviter les remontées d’air dans le dos, constitue un avantage.
Le pantalon. Un pantalon d’hiver doit être épais, résistant et remonter assez haut pour ne pas laisser passer l’air.
Choisir de préférence un modèle à bretelles qui ne comprimera pas le ventre et proégera les reins. Evidemment, les protections contre la chute, homologuées 1621-1, comprendront des coques aux genoux ainsi que des plaques de mousse sur les hanches, voire le coccyx. Un bon pantalon doit s’ajuster correctement au niveau des mollets, de manière à bien enserrer les bottes.
Si l’équipement est un élément essentiel pour rouler confortablement, il ne suffit pas d’enfiler un blouson ou une veste estampillée « grand froid » pour se mettre à l’abri: les performances de ces vêtements s’avèrent inégales et souvent décevantes. A défaut de pouvoir tester soi-même l’ensemble des gammes des différents équipementiers, il faudra se référer aux essais menés chaque année par la presse moto spécialisée, notamment “Motomag” et “L’Intégral”, qui réalissent régulièrement des comparatifs de vêtements d’hiver.
Pour 2007, sont recommandés:
- par Motomag : blouson MacAdam Scrambler (230 euros), bien isolé mais peu étanche et vieillit vite ; blouson Spidi Armada (310 euros), très bien en version hiver avec doublure, moins intéressant en mi-saison ; gants Furygan, modèle Land (70-80 euros), ou Ixon, modèle Pro Shell (80 euros).
- par L’Intégral : veste BLH Voyager (200 euros), mais à porter avec un bon tour de cou ou un plastron ; gants Alpinestars 365 Gore-Tex (18 euros) ; blouson Ixon Timeless (350 euros) ; pantalon Dainese 2L GoreTex (290 euros) ; bottes Rev’It Ergo Boots (150 euros).
N’hésitez pas à vous référer aux tests des années précédentes, vous pourrez économiser en achetant des modèles “démodés” mais encore en stock, voire d’occasion.
Pour être économe, soyez prévoyant: les vêtements moto d’hiver s’achètent à pas cher en été, lors des soldes de juillet.
Reste à optimiser l’efficacité de vos vêtements par une utilisation adaptée.
La règle de base est de superposer plusieurs couches d’habits (généralement trois), de façon suffisamment ample pour pouvoir bouger, tourner la tête, ne pas comprimer les articulations (coudes, épaules, bassin, cou, genoux), ni oppresser la cage thoracique. En effet, sous l’effet du froid, le travail de l’appareil cardio-respiratoire est renforcé. Le rythme et l’intensité des inspirations-expirations augmentent, le plus souvent sans que nous en ayons conscience. Veiller à ne pas trop serrer les divers passants, sangles et ceintures.
Ne tombez pas dans la “paranoïa de la couche” en vous disant: “au plus je mets de couches, au plus j’aurai chaud !”
Au contraire ! Au plus il y a de couches, au plus vite vous transpirez, ce qui refroidit la peau. De plus, si vous n’avez pas de vêtements respirants, cette sueur reste sur la peau et vous refroidira encore plus. Un t-shirt, un pull (ou une sous-veste) et une bonne veste suffisent bien souvent.
Si vous devez régulièrement affronter des températures glaciaires sur de longs trajets, investissez dans un gilet chauffant, de moto ou de plongée sous-marine (les meilleurs à mes yeux viennent de chez Klan, mais il y en a aussi chez Gerbing, Dainese, BMW, Chilli…), qui vous gardera le torse au chaud, le sang sera chauffé au niveau du coeur, il ira irriguer et réchauffer l’ensemble de votre organisme.
Si vous êtes bricoleur, lire comment fabriquer un gilet chauffant artisanal.
Une solution intermédiaire qui n’a pas encore complètement fait ses preuves, le gilet BMW AirVantage.
Pour conserver la chaleur, gardez à l’esprit la règle des trois couches.
La première couche est portée à même la peau, en général constituée d’un sous-vêtement technique constitué de deux épaisseurs, une face interne en polyester, polyamide ou polypropylène, qui va se charger d’évacuer l’humidité, et une face externe (en laine par exemple) qui va sécher rapidement tout en assurant une isolation thermique. Préférer les coupes ajustées, au plus proche de la peau, avec maille extensible (style Lycra). Proscrire absolument les vêtements en coton qui n’évacuent pas l’humidité et ne sèchent pas. Des sous-vêtements de randonnée, de ski ou d’alpinisme, trouvables en grandes surfaces de sport, ou le bon vieux Damart font parfaitement l’affaire.
Quelques exemples de fibres techniques: Dryflo, Carline Polartec, Capilène, Coolmax, Confortemp, Thinsulate, Primaloft…
La deuxième couche assure l’isolation et le maintien de la chaleur produite par le corps. Constituée de fibre polaire triple couche, légère et peu épaisse, elle remplace avantageusement un gros pull de laine qui procurerait une sensation d’engoncement. Une simple polaire, à moins d’être doublée d’une couche coupe-vent, laisse passer le vent, elle devra être portée avec une couche supplémentaire de protection (en Windstopper, par exemple) pour être efficace. On trouve des sous-vestes très bien chez Décathlon dans la gamme Forclaz.
Principaux matériaux utilisés dans cette catégorie: Microfleece, Polarfleece, Polartec, Windpro…
La troisième couche assure la protection contre le vent, la pluie et la neige. Exemples de membranes coupe-vent: Windbear, Windstopper, Antifreeze… Privilégiez une protection extérieure respirante et imperméable: membrane Gore-Tex (exclusivement par DuPont qui fournit de nombreux équipementiers) ou Sheltex (par Hein Gericke). Le prix du Gore-Tex est dissuasif (coût de la licence), mais le confort est au rendez-vous dés lors que vous avez une pratique hivernale assidue. Attention, l’appellation “GoreTex” ne suffit pas, regardez le nombre de couches (de 1 à 4), la protection n’est pas la même…
Un traitement déperlant peut constituer un avantage. A l’inverse, évitez toutes les matières qui vont se gorger d’eau, notamment le cuir. Ou alors, il faut qu’il soit imperméabilisé hydrophobe et/ou surmonté d’une couche étanche, comme ne cominaison de pluie.
Oubliez le K-Way, la toile cirée et les autres matériaux étanches non respirants qui vont transformer votre veste en sauna. Le Windstopper seul peut convenir, mais s’il pleut, il se transformera en éponge.
-
Comment est constituée une batterie électrique de moto ? Comment lui assurer longue vie, fiabilité et une fin honorable ?
On tend souvent à négliger la batterie lors des inspections de routine du fait qu’elle est bien cachée, qu’elle ne fait aucun bruit et qu’elle ne se fait remarquer que par sa défection complète. Or, comme tous les autres organes, la batterie doit être vérifiée à intervalles réguliers pour s’assurer qu’elle est en bon état de fonctionnement. A moins qu’elle ne soit de type “sans entretien”, il est bon d’y jeter un coup d’oeil toutes les semaines ou au moins tous les quinze jours.
Les pannes électriques sont en effet celles que le motard redoute le plus.
Pourtant, la complexité apparente d’un schéma électrique est trompeuse. La plupart des circuits peuvent être divisés en sections plus simples. La source d’énergie, en principe la batterie ou l’alternateur via la batterie, alimente un appareil consommateur par un fil conducteur. Le courant retourne à la source par un fil de masse (généralement relié au cadre de la moto) et le circuit est fermé.
Qu’est-ce qu’une batterie ?
La batterie fournit le courant nécessaire au fonctionnement du démarreur et à l’allumage pendant la phase de démarrage (sauf dans le cas où l’on trouve un volant magnétique, mais ça se fait rare). Elle sert aussi de réserve de courant aux équipements consommateurs de la moto chaque fois que le moteur tourne à un régime trop lent pour que le générateur débite un courant suffisant.
Les batteries de motos modernes sont en intensité 12 volts.
La capacité de la batterie est indiquée en ampères-heures (A/h). Ainsi, une batterie classée 10 A/h peut débiter, dans certaines conditions normalisées, 10 ampères pendant une heure ou 1 ampère pendant 10 heures.
La majorité des batteries de motos sont de type plomb-acide, mais on trouve de plus en plus des batteries de type gel.
Les batteries au gel et les plomb-acide dites “sans entretien” ne réclament, comme le nom l’indique, aucun entretien ni remise à niveau des liquides. Cet article traite donc principalement des batteries dites “classiques”.
Une batterie plomb-acide est constituée d’une série d’éléments séparés contenus dans un bac commun. Une batterie de 12 volts en comporte six. Chaque élément forme un petit bac séparé à l’intérieur de la batterie. Chaque élément est fait de deux jeux de plaques alternées, positives et négatives, qui sont en fait des grilles. Les plaques positives sont recouvertes de péroxyde de plomb après charge (de couleur brune) et les plaques négatives de plomb métallique spongieux (de couleur grise).
Les plaques positives, comme les plaques négatives, sont reliées entre elles par des pontets et chaque jeu est connecté à la borne extérieure correspondant à sa polarité sur le dessus de la batterie.
Chaque élément contient plusieurs plaques, mais il y a toujours une plaque négative de plus afin que chaque plaque positive soit placée entre deux plaques négatives. Entre les plaques, on place des séparateurs en carton traité, en plastique ou en fibre de verre qui empêchent tout contact générateur de court-circuit entre les plaques.
Les éléments sont remplis d’une solution d’acide sulfurique et d’eau, l’électrolyte, contenant environ 60 % d’eau et 40 % d’acide, d’où l’appellation « batterie plomb-acide ».
La batterie est donc un générateur électrochimique, un appareil qui transforme la réaction produite par l’électrolyte sur les plaques en énergie électrique. Cette réaction finit par produire des résidus inactifs qui tombent au fond des éléments dans l’espace réservé sous les plaques. En outre, la décomposition de l’eau produit un mélange gazeux qui s’échappe de la batterie alors que la solution acide se concentre.
Il faut par conséquent remettre de l’eau distillée lorsque le niveau de l’électrolyte est trop bas. N’ajoutez pas d’acide sulfurique pour relever le niveau car l’électrolyte trop fort attaquerait les plaques. Le métal retiré des plaques tombant alors dans les chambres de décantation risquerait de causer un court-circuit interne, mettant la batterie hors d’usage.
Pourquoi une batterie se décharge-t-elle ?
En service normal, la batterie est chargée par l’alternateur de la moto entraîné par le moteur. Il peut arriver cependant que, dans certaines conditions d’emploi, la batterie soit à plat. Il faut alors la retirer de la moto et la recharger avec un appareil spécifique (un chargeur), branché sur le réseau domestique.
C’est souvent le cas avec les motos utilisées sur de très courts trajets au cours desquels la génératrice n’a pas le temps de recharger la batterie vidée par les coups de démarreur, ou lorsque le moteur ne tourne qu’à bas régime et que l’alternateur ne parvient pas à compenser par son débit la consommation des appareils qui doivent puiser dans les réserves de la batterie.
Si la moto n’a pas été utilisée pendant un certain temps, la batterie peut être déchargée car il se produit constamment des réactions chimiques dans une batterie, même complètement déconnectée du circuit, et ces réactions conduisent à une décharge lente, mais complète, appelée auto-décharge.
Si la batterie est en bonne condition, cette auto-décharge peut atteindre 1 % par jour. Si votre batterie est à plat après seulement quelques jours d’inactivité, elle est certainement hors d’usage et doit être remplacée d’urgence.
Autre inconvénient de cette auto-décharge: le sulfate de plomb qui se forme sur les plaques est plus dur à attaquer lors de la recharge. Aussi, lorsque la moto est arrêtée pendant une longue période, sa batterie doit être rechargée si la mesure du voltage indique qu’elle n’est chargée qu’à 50 % ou moins de sa capacité totale. Si vous négligez cette précaution, la formation d’une grande quantité de sulfate de plomb sur les plaques rendra la batterie inutilisable.
Comment vérifier l’état de la batterie ?
Il n’est guère pratique de vérifier l’état de charge d’une batterie de moto en mesurant la densité de l’électrolyte car elle ne contient pas assez de liquide pour en prélever avec une pipette pèse-acide. Il faut utiliser un voltmètre relié aux bornes extrêmes de la batterie.
Une batterie de 12 volts doit avoir une tension propre entre bornes de l’ordre de 12,5 volts et doit être rechargée si cette tension descend au-dessous de 11 volts. Lorsque la batterie est chargée, la tension aux bornes doit être d’environ 15 volts. Sur les motos équipées d’un démarreur électrique, la tension d’une batterie 12 volts bien chargée doit chuter entre 8 et 10 volts lorsque le démarreur est lancé.
On peut parfois se rendre compte visuellement de l’état de charge d’une batterie. Lorsqu’elle est totalement chargée, les plaques positives sont d’une couleur brun foncé. Si elle est déchargée, celles-ci sont d’un brun plus pâle. Les plaques négatives, gris métal, ne changent pas de couleur selon l’état de charge.
Des dépôts blanchâtres sur les plaques indiquent que la batterie doit être remplacée.
En premier lieu, contrôlez le niveau de l’électrolyte (le liquide). Les batteries “classiques” ont un bac transparent grâce auquel on peut voir immédiatement le niveau de l’électrolyte. Le minimum et le maximum sont indiqués par des traits horizontaux tracés à la partie supérieure du bac.
En fonctionnement normal, la batterie perd de l’électrolyte en petites quantités soit par évaporation, soit par transformation de l’eau en hydrogène et en oxygène, gaz formés lors de la charge effectuée par le générateur de la moto, et évacués par les évents de la batterie. La batterie ne doit pas être trop remplie, l’excès d’électrolyte serait évacué par évents lors de la charge.
Encore une fois, tout cela n’est pas valable pour les batteries dites “sans entretien”, qui sont toutes noires.
Les bornes de la batterie ne doivent présenter aucun signe de corrosion. Si c’est le cas, il faut les nettoyer avec un papier abrasif fin (ou toile émeri). On peut aussi recouvrir les bornes d’une graisse spéciale pour les protéger. C’est un point important car des bornes corrodées offrent un mauvais contact électrique et s’opposent au passage du courant. Le démarrage en est affecté en premier lieu car l’allumage et le démarreur dépendent uniquement de la batterie tant que le moteur n’a pas atteint un certain régime.
Assurez-vous que l’évent de la batterie n’est pas bouché car, dans ce cas, les gaz ne peuvent être évacués. La pression augmente alors dans le bac dans une proportion telle que celui-ci peut se fendre. On a vu des batteries exploser par suite d’une accumulation de gaz sous pression dans le bac. Vérifiez donc que le bac n’est pas fêlé. Des signes de corrosion blanchâtre sur le porte-batterie indiquent que la batterie a eu des fuites. Si la moto est tombée de sa béquille, il est possible que le bac de la batterie ait été cassé, même si, apparemment, le reste de la machine n’a pas souffert. La plupart des batteries sont maintenues par une courroie élastique. Vérifiez son état et son positionnement. Une des causes les plus fréquentes de fêlures des bacs de batterie est une courroie cassée ou mal montée. Vérifiez aussi les cales de caoutchouc placées au fond du porte-batterie et assurez-vous de leur bon état.
Enfin, soyez très précautionneux lorsque vous manipulez une batterie afin que l’électrolyte ne vienne pas en contact avec votre peau. L’acide sulfurique, même dilué, peut causer de très désagréables brûlures. Il faut, dans ce cas, se laver immédiatement à l’eau courante pendant plusieurs minutes. Si de l’électrolyte pénétrait dans vos yeux, lavez-les aussitôt sans attendre à l’eau courante et consultez un médecin. L’acide sulfurique peut rendre aveugle.
Comment recharger la batterie ?
Si une basse tension montre que la batterie doit être rechargée, démontez-la de la moto et reliez la batterie au chargeur, le fil + (rouge) à la borne positive et le fil - (noir) à la borne négative. Vérifiez bien que le branchement est correct (le + au + et le - au -) et que les pinces donnent un bon contact.
Sur une batterie classique, dévissez les bouchons fermant les éléments pour assurer l’aération.
Précision: sur les motos BMW récentes, il est possible de recharger la batterie au gel sans la démonter en branchant un chargeur spécifique directement sur une des prises de bord. Pour les autres, il faut démonter la batterie.
Branchez le chargeur et laissez la batterie en charge quelques heures (ou une nuit).
Il faut un chargeur spécifique moto avec une intensité de l’ordre d’un dixième de la capacité (en ampères/heure) de la batterie. Dans ces conditions, une charge lente complète prend une dizaine d’heures.
La référence dans ce domaine est le Tecmate Optimate III, un chargeur “intelligent”, capable de détecter le niveau de charge de la batterie et d’adapter l’intensité de la recharge en fonction. Convient pour toute batterie acide-plomb de 12 V d’une capacité de 2,5 à 18 Ah, y compris les batteries étanches de démarrage du type “MF” (soit chargées à sec, soit du type “MF humide” déjà remplies et chargées en usines), pour motos et véhicules assimilés mais également pour les batteries étanches de type gel.
Lire un un essai
Débranchez le chargeur et déconnectez-le de la batterie. Vérifiez la tension entre les bornes.
Si la tension est remontée, vérifiez le niveau de l’électrolyte et complétez pour compenser l’évaporation qui s’est produite pendant la charge. Recontrôlez la tension après une demi-heure. Essuyez le dessus de la batterie, remettez les bouchons et remontez la batterie sur la moto.
Si la tension est toujours basse, remettez la batterie en charge. Si la batterie ne prend pas la charge ou si elle se décharge rapidement, elle doit être remplacée.
En cas de remplacement de la batterie, assurez-vous que la capacité (Ah) est identique.
La mise en charge d’une batterie donne lieu à la production d’un mélange gazeux explosif. Ne fumez jamais à proximité d’une batterie en charge (choisissez un lieu ventilé) et ne faites pas d’étincelles.
Point important: il est déconseillé de mettre régulièrement une batterie de moto en charge sur un chargeur auto.
Celui-ci délivre en effet une puissance trop importante, calibrée pour les batteries de voiture qui sont bien plus puissantes que celles pour motos.
Toutes les deux sont certes en 12 volts, mais avec une intensité différente. Or il faut dans l’idéal utiliser un chargeur qui recharge lentement, avec une intensité de l’ordre d’un dixième de la capacité (en ampères/heure) de la batterie.
Une charge lente évite aux plaques internes de se déformer et de se dégrader.
Une charge trop rapide, avec un chargeur auto, diminuera la durée de vie de la batterie moto.
Mais cela reste possible en solution d’appoint.
Autres vérifications électriques
Après avoir vérifié la batterie, vous devez faire un rapide contrôle des lampes et de leur fonctionnement. N’oubliez pas de contrôler aussi le feu stop.
Indépendamment de l’aspect réglementaire, les lampes défaillantes peuvent causer un accident fatal. Il est prudent d’emporter toujours avec soi des ampoules de rechange pour l’avant, l’arrière et les clignotants.
En dernier lieu, vérifier le fonctionnement de l’avertisseur. On ne mesure jamais assez l’importance d’un équipement tant qu’une utilisation d’urgence ne s’impose pas en découvrant qu’il ne fonctionne plus.
-
Améliorer l’éclairage
Si vous êtes appelé à rouler fréquemment dans l’obscurité, commencez par changer l’ampoule de feu de route de votre machine pour en mettre une plus efficace.
Des essais sur les performances des différentes ampoules commercialisées par les grandes marques sont publiés régulièrement dans la presse spécialisée moto. La gamme Megalight “+60%” de General Electric est en général reconnue pour ses bons résultats.
Ne vous fiez pas à la couleur de l’ampoule: une ampoule bleue n’est pas forcément au xénon, elle est juste teintée en bleu pour délivrer une lumière proche de celle du jour. Les lampes bleues, dites “all day” ou “all weather”, relèvent souvent de l’astuce marketing.
Certains motards préfèrent remplacer leurs ampoules classiques 55-60 watts par des ampoules 100 watts (voire 130 watts). Il est évident que le gain de puissance améliore la portée et l’intensité du faisceau lumineux. Mais les ampoules 100W sont interdites, elles éblouissent trop les usagers qui arrivent en face. Si vous prenez le risque de mettre une ampoule 100 watts, soyez respectueux des autres, gardez le doigt sur l’interrupteur de phares et repassez en feu de croisement dès qu’une voiture se profile à l’horizon.
Autre solution, monter des feux additionnels (homologués route, évidemment).
Cela peut se faire de façon très simple sur la plupart des modèles de motos. C’est plus difficile sur un scooter. Il s’agit de feux anti-brouillard (AB) ou longue portée (LP, parfois au xénon dans ce dernier cas) qui sont raccordés au faisceau électrique de la moto, commandés soit par un interrupteur spécial, soit sur l’interrupteur habituel, et montés à l’avant de la machine, au niveau du tête de fourche ou sur la fourche ou sur les cylindres ou sur des arceaux spécifiques. La plupart réclament des supports spéciaux et un minimum de compétences en électricité pour les raccorder au faisceau.
Dans le cas de feux AB, il vaut mieux les monter le plus bas possible car leur forte intensité lumineuse peut facilement éblouir les autres usagers. Pour les feux LP, c’est l’inverse: les mettre assez haut (entre 50 cm et 1,50 m du sol) permettra une meilleure portée (en pensant toujours à les éteindre avant de croiser un autre véhicule venant en face).
Si vous roulez très souvent de nuit, la solution-miracle s’appelle “xénon” ! A condition que votre moto permette le changement du feu.
Montez une ampoule xénon sur votre feu de route, et que la lumière soit. J’en ai mis un sur ma GS et le résultat est spectaculaire, j’y vois (presque) comme en plein jour. L’éclairage est meilleur que celui de la Toyota Corolla de mon père…
Autre avantage, une lampe à décharge au gaz xénon (nom officiel) dispense trois fois plus de puissance pour une consommation deux fois moindre en fonctionnement constant. Elle consomme par contre beaucoup lors de son allumage, d’où la nécessité d’un ballast de puissance, un boîtier qui est chargé de générer un arc électrique constant de 300 Hz.
Principe de fonctionnement: au lieu d’un filament porté à incandescence, l’ampoule xénon contient un gaz dans lequel deux électrodes produisent un puissant arc lumineux. Il faut quelques secondes pour que cet arc parvienne à pleine puissance, c’est pourquoi un phare xénon à froid n’éclaire pas tout de suite efficacement. Une fois le gaz à température, on peut éteindre et rallumer le phare sans perte de luminosité.
Monter un phare au xénon impose de changer le feu en entier, pas juste l’ampoule, et de monter le ballast de puissance. A moins de le faire vous-même, prévoyez un petit budget de main-d’oeuvre en plus du coût des pièces, déjà élevé (autour de 300 euros).
BMW est le premier constructeur moto à proposer un phare au xénon d’origine, en option sur la K1200GT. Mais vous pouvez faire changer le feu de route des GS pour mettre un xénon de chez Touratech. Dernière possibilité, monter un LP au xénon, disponible chez Touratech et Wunderlich.
Dans tous les cas, rappelez-vous qu’une ampoule “classique” à incandescence perd environ 50% de son efficacité au bout d’environ deux ans. D’autant plus que dans notre cas, le feu de croisement est allumé en permanence. Il faut donc ne pas hésiter à la remplacer avant deux ans.
Etre bien vu
C’est une question de simple survie. Cela repose avant tout sur les bonnes performances de l’éclairage de votre deux-roues, notamment à l’arrière (on va supposer que les feux avant fonctionnent bien), et sur la présence d’éléments réfléchissants sur votre moto et sur vous-même.
Rouler de nuit avec un feu arrière hors service, en tenue noire, sans réflecteurs revient à jouer à la roulette russe.
Etre vu s’avère encore plus vital en cas de panne ou d’arrêt sur la route de nuit. Vous devez alors impérativement allumer vos feux de détresse (ou un clignotant si votre moto ne dispose pas de warnings) et enfiler un gilet haute visibilité.
Première précaution, contrôler régulièrement votre feu arrière (feu de position et feu stop).
Si vous estimez qu’il est vraiment trop faible, remplacez-le par un feu à diodes électroluminescentes, dites aussi “leds”. Cela coûte un peu (environ 30 euros hors montage), mais la luminescence est bien plus forte. Et en plus, le temps de réaction est moindre que celui d’une ampoule à incandescence. Le quart de seconde gagné peut éviter de vous faire rentrer dedans sur un freinage brutal…
Deuxième idée, porter le plus grand nombre de filets réflecteurs sur vos vêtements de moto.
Trop de motards, notamment ceux qui portent du cuir, ne disposent que des réflecteurs obligatoires présents sur leur casque (quand ils ne les ont pas enlevés). Dans l’idéal, il faut un réflecteur sur chaque pièce d’équipement: casque, veste ou blouson, gants, pantalon, bottes. Le matériau 3M Scotchlite est le plus efficace et ne coûte pas cher.
Pour rendre votre casque intégral encore plus visible, une bonne solution est le bandeau Halo en néoprène enduit de Scotchlite. A ma connaissance, ce produit n’est hélas pas encore vendu en Europe, il faut le commander aux Etats-Unis.
Autre élément de sécurité passive, porter un équipement rétroréfléchissant: gilet, chasuble, harnais, brassard…
Les brassards s’avèrent en général trop petits pour être réellement efficaces à plus de quelques mètres. Les gilets les chasubles donnent un look un peu trop “Playmobil” et ne sont souvent pas adaptés à la vitesse, ils gonflent sous le vent relatif et la fermeture velcro peut parfois lâcher.
La meilleure solution à mon sens est le harnais ou la bandoulière, à microbilles ou microprismatique (avec un avantage pour cette dernière technologie). Je porte personnellement un harnais croisé de la DDE, mais un bon équipement est la bandoulière de Reflexite, vendue 12 euros chez Décathlon. Le look “gendarmerie” peut en rebuter certains, mais il possède un effet dissuasif certain sur les automobilistes.
Choisissez de préférence un produit homologué aux normes européennes. La plus exigeante est la EN 471 (vêtements professionnels en utilisation extrême), mais exigez au moins la norme EN 1150 (vêtements à usage non professionnel) ou EN 13356 (accessoires non professionnels).
Si vous ne voulez pas vous encombrer de réflecteurs intégrés ou à enfiler, la solution est d’en mettre à demeure sur votre moto. Avantage: vous ne les oublierez jamais. Inconvénient: ils coûtent souvent plus chers et doivent être régulièrement remplacés.
Première possibilité, les catadioptres, ronds ou triangulaires, à poser à l’arrière et sur les côtés du carénage ou des valises. Pour les triangles, voyez chez Cardox, qui vend à environ cinq euros des triangles de microbilles. Un petit catadioptre rond de 6 cm de diamètre coûte moins d’un euro et peut se fixer partout, ça se trouve dans n’importe quel magasin d’équipement auto (Feu Vert, Norauto, Eldorauto…).
Autre solution, un “spot glow”, un petit rond autoluminescent qui dégage une lumière vive durant plus de cinq heures. Vendu à 3,50 euros sur la boutique du site Sécurité routière (site privé non gouvernemental).
Deuxième possibilité, poser des autocollants réfléchissants sur la moto, notamment sur les valises et/ou le top-case.
J’utilise personnellement ceux du site américain Reflective Decals, pas trop chers (si ce n’est qu’il faut payer les frais de port depuis les Etats-Unis, faites plutôt une commande groupée), bien faits et très résistants. Certains sont découpés spécialement pour tel ou tel modèle de moto (surtout pour les BMW), d’autres sont universels, comme les chevrons. Vous les trouverez également chez Cycle Gadgets.
La société Midway commercialise en France un produit vaguement semblable, mais sous forme de filets à poser sur les côtés des jantes. Beaucoup moins efficaces, surtout qu’ils se salissent facilement. Mais bon, à 10 euros les cinq mètres, cela ne gâche rien d’essayer.
-
Un conducteur de deux-roues moteur est forcément amené à rouler de nuit, que ce soit pour une longue étape qui commence tôt et finit tard, sur ses trajets quotidiens en hiver quand la nuit tombe à 17h30, si une balade se termine plus tard que prévu ou qu’il veuille partir tôt pour éviter les bouchons… Mais un trajet de nuit ne s’improvise pas.
La nuit, le risque d’accident est deux fois plus élevé que le jour. Pire encore, la nuit représente moins de 10% du trafic, mais 45% des tués sur la route: les usagers ont tendance à rouler plus vite sous prétexte que la route est dégagée. Et chacun sait que la vitesse est un facteur aggravant en cas d’accident.
Rouler “de nuit” en moto, cela veut dire conduire dans un environnement sombre et froid (enfin, plus froid qu’en journée).
Non seulement vous voyez moins bien, moins loin, moins précis, mais vous êtes aussi moins bien vu. Déjà qu’un deux-roues n’est pas bien perçu (dans tous les sens du terme) de jour par une majorité d’automobilistes…
Il s’agit donc de trouver les meilleurs moyens de conserver à la fois une bonne vision et une bonne visibilité.
Un point rapide sur le froid.
La température peut chuter très vite dès que le soleil se cache. Si vous prévoyez d’effectuer un trajet en fin de journée ou en soirée, surtout après un bon repas (même sans alcool), pensez à emmener une épaisseur supplémentaire ou une surveste coupe-vent. Avec la digestion, la température du corps baisse, on a froid plus facilement, on se crispe, on tremblote et la vigilance baisse. Si le trajet doit durer un peu, des gants plus chauds et un surpantalon ne seront pas de trop…
Sur ce point précis, lire l’article “Rouler en deux-roues en hiver“.
Bien voir
Le principal problème que pose la conduite de nuit, c’est bien sûr qu’on y voit moins bien.
Au crépuscule, on estime qu’un conducteur doté d’une excellente vue voit aussi “bien” (ou plutôt, aussi mal) qu’une personne légèrement myope, avec une perte de vision de l’ordre de 1,5 dioptrie. Le problème n’est pas tant la diminution du champ visuel que la perte de contrastes. C’est pourquoi on dit que “la nuit, tous les chats sont gris”.
Le sens de la profondeur, la notion de relief, l’appréciation des distances s’avèrent sept fois moins développés que le jour. Même pour des conducteurs dotés d’une excellente vue, les distances et les vitesses sont sous-estimées.
De nuit, une voiture qui arrive en face parait plus éloignée qu’elle ne l’est réellement. Faites attention avant d’entamer un dépassement un peu “limite”.
La première des réactions doit être de diminuer la vitesse de conduite, on ne roule pas aussi vite de nuit que de jour (sauf éventuellement sur autoroute éclairée). Comme expliqué dans l’article “Où regarder ?“, il faut adapter sa vitesse à la portée de son champ visuel. A moins que la route soit éclairée par des lampadaires, notre champ visuel va se trouver réduit à la portée des phares du deux-roues, soit un étroit faisceau sur une distance limitée…
Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la plupart des constructeurs ne font pas beaucoup d’efforts de ce côté-là !
Aucune prescription n’est donnée par le Code de la route (articles R.313-1 à R.32) pour le feu de route. Dans la pratique, la portée moyenne du feu de route est d’environ 100 mètres. Le feu de croisement (code) doit lui éclairer à au moins 30 mètres sans éblouir. Ce qui signifie qu’il faudrait rouler à 50 km/h pour rester certain de s’arrêter totalement avant un obstacle que vous voyez au dernier moment dans le faisceau de votre feu de croisement. Non seulement c’est peu, mais aucune mesure de luminosité n’est donnée. Or il y a une différence entre “éclairer” et “bien éclairer”…
Le premier point fondamental pour rouler en sécurité de nuit consiste logiquement à se doter d’un éclairage efficace, surtout vers l’avant.
Et la première précaution élémentaire, c’est tout simplement de garder son optique de phare propre. Un verre de phare sale (poussière, traces d’eau de pluie, boue), c’est jusque 30% de luminosité en moins et un gros risque d’éblouir ceux qui arrivent en face (à cause de la diffraction). Gardez toujours un chiffon pour nettoyer votre phare ou piquez des serviettes en papier ou du papier toilette au resto, à la station d’essence… pour le nettoyer régulièrement au cours d’un long trajet, surtout par temps de pluie ou en été (à cause des insectes). Les voitures, et surtout les camions, derrière lesquels vous roulez sous la pluie, envoient des projections qui dégradent progressivement l’éclairage de votre moto.
Dans la même logique, toute trace sur l’ampoule, graisse, humidité, va s’évaporer et réduire la performance. Une ampoule ne se manipule jamais avec les doigts, mais à travers un chiffon propre ou la tenant par le beep.
Autre précaution de base, régler son phare, c’est-à-dire la hauteur du faisceau d’éclairage. Un truc simple: placez la moto à dix mètres d’une paroi verticale, montez en selle, le faisceau doit porter le plus haut possible mais sans dépasser la hauteur du phare lui-même. N’oubliez pas que la hauteur d’éclairage varie en fonction de la charge sur la moto (bagages, passager).
La seconde précaution, c’est d’éviter toute perte de vision et de luminosité, donc de conserver un écran de casque absolument nickel, propre et sans rayures.
Bien évidemment, ne roulez jamais de nuit avec un écran teinté, même s’il est dit “fumé clair”. Il est bien marqué “daytime use only” ! Un écran teinté noir réduit énormément l’acuité visuelle. Si vous voulez rouler à la fois de nuit et par grand soleil, portez des lunettes de soleil ou choisissez un casque doté d’un double écran solaire escamotable.
Si vous portez des lunettes, il faut bien sûr les garder propres. Un petit coup de lingette ou de chiffon microfibre spécial verres sera le bienvenu avant un trajet de nuit.
Si votre écran de casque est doté d’un “pinlock”, une bonne idée est d’acheter un double écran de couleur jaune, qui va augmenter les contrastes. J’en ai utilisé un sur un casque de prêt, c’est franchement efficace.
Le plus horrible, c’est de rouler de nuit et sous la pluie.
On n’y voit rien, tout scintille, les contrastes sont totalement abolis, tout se confond. Sans parler de la buée qui se forme rapidement et gêne encore plus la vision. En cas de grosse pluie, le mieux est encore de laisser l’eau ruisseler et être évacuée par le vent de la vitesse. A partir de 100 km/h, les gouttes s’écoulent toutes seules sur l’écran. Le vrai problème, c’est la petite pluie fine en ville ou à faible vitesse, qui laisse sur votre écran une myriade de goutelettes qui ne ruissellent pas. Et si on essaie de nettoyer avec le gant, c’est encore pire, tout devient flou. Seule solution, mettre l’essuie-glace: une raclette sur l’index du gant gauche, soit intégrée d’origine (c’est le mieux), soit à enfiler sur le doigt (avec le risque qu’elle tourne si elle n’est pas assez serrée, mais ça fait mal si elle serre trop). Si vous n’en avez pas, la seule issue est de réduire drastiquement votre vitesse.
Autre problème rencontré quand on roule de nuit et plus encore sous la pluie, c’est l’éblouissement.
Beaucoup de voitures roulent avec des phares mal réglés, un faisceau trop puissant ou trop haut. Si vous voyez une voiture arriver pleins phares, plissez les yeux et regardez en bas à droite, vers le bas-côté extérieur de la route. Ne regardez surtout pas les phares “droit dans les yeux” comme un lapin hyptonisé, votre rétine en prendrait plein les mirettes avec un effet de rémanence qui peut durer plusieurs secondes, voire minutes.
Cet inconfort s’aggrave avec les années: la résistance à l’éblouissement diminue fortement après 40 ans.
Si jamais vous êtes ébloui, ne fermez pas les yeux, mais clignez des paupières plusieurs fois très vite, cela aide vos yeux à recouvrer leur bonne vision.
Dans le noir, les yeux se fatiguent plus vite. Lors de longs trajets, pensez donc à faire des pauses plus fréquentes que de jour afin de reposer vos yeux.
Lors de ces pauses, évitez une trop grande différence d’éclairage. Gardez vos yeux dans une ambiance de semi-pénombre en les plissant ou en portant des lunettes fumées si l’éclairage ambiant est trop fort. Cela peut paraître un peu idiot de mettre des lunettes de soleil la nuit, mais c’est ce que font les professionnels de la route. L’oeil met plusieurs minutes à s’habituer à un éclairage: si vous reprenez la route après avoir été exposé à une forte lumière, votre vue sera dégradée le temps que vos yeux s’habituent à l’obscurité. Le risque d’accident est multiplié pendant cette période d’adaptation.
-
-
voici un site avec des conseils et des videos pour l'entretien mecanique
-
Comme promis hier, voici quelques photos en attendant les commentaires qui suivront mais un peu plus tard car là j'ai rencard dans un quart d'heure et je ne peux pas le finaliser, à toute...

http://img519.imageshack.us/slideshow/play...6337253izd.smil
Bon vlà les infos :
outils et matériels nécessaires :
- une clé plate de 10
- un morceau de tuyau de diamètre 5mm environ
- un récipient (type vieille bouteille d'eau 50cl)
- du liquide de frein/embrayage, pour mon ZRX du DOT4 (vérifiez sur votre notice la qualité)
- des chiffons
- un tournevis cruciforme
comment procéder : (ce procédé est valable pour purger les freins avant et arrière et l'embrayage)
- ôter le capuchon de la vis de purge qui setrouve sur votre étrier
- y mettre un côté du tuyau flexible de 5mm
- mettre l'autre côté du tuyau dans le récipient contenant du liquide de frein/embrayage (veiller à ce que le bout du tuyau soit immergé dans le liquide neuf afin d'éviter à l'air de remonter le circuit)
- dévisser avec le cruciforme les vis du capot protecteur du bocal de frein (pour l'avant) mettez un chiffon autour
- enfoncer le levier du frein et le maintenir enfoncé (soit manuellement soit à l'aide d'une sangle ou d'un morceau de cordelette)
- à l'aide de la clé de 10 desserrer légèrement la vis de purge (vous allez alors voir le liquide passer par le tuyau)
- relâcher le levier et pomper jusquau vidage de votre bocal MAIS pas complétement (il doit toujours rester un fond de liquide afin d'éviter la propagation de bulles d'air)
- en maintenant de nouveau le levier enfoncé, resserrer la vis de purge et remplir le bocal complétement de liquide neuf
- redesserrer la vis de purge et pomper sur le levier jusqu'à ce que le liquide passe sans bulle d'air, remplir si besoin le bocal
- attention lorsque vous allez pomper, du liquide risque de gicler, le chiffon placé au préalable devrait assurer et/ou éviter les éclaboussures
- maintenir le levier enfoncé et resserrer la vis de purge, doucement car ces vis sont fragiles, essuyer replacer le capuchon dessus
- recompléter au niveau le liquide dans le bocal et replacer le couvercle, essuyer
- actionner le levier, pomper un peu il est dur et ça freine
- temps de l'opération complète = moins d'une heure - gain de l'opération = si vous faites les freins + l'embrayage entre 1h et 2h de main d'oeuvre chez le garagiste
N.B. si le frein ne répond pas ou pas bien, il faut répéter l'opération du serrage de la poignée, desserrage de la vis de purge et du pompage jusquà ce qu'il n'y ai plus de bulle d'air dans le circuit.
Comme constaté par la dernière photo du petit diaporama que je vous ai mis précédemment, je possède la revue moto technique de ma moto, je vous conseil de vous la procurer, c'est la "bible" pour faire ses entretiens. Vous en trouverer soit sur le net soit dans vos magasins de moto préférés.
Allez, bonne chance.
Si certain(e)s ne se sentent pas de se lancer seul(e)s dans ce genre de réparation, je me tiens à votre disposition pour vous donner un coup de main, en fonction de ma disponibilité bien entendu.

petite video :
-
voici un lien efficace pour comprendre les 5 elements suivants :
- Nombres de cylindres
- Position du moteur
- Transmission
- Refroidissement du moteur
- Moteur 2T ou 4T.
-
Les avantages de la puissance:
La moto est plus nerveuse, plus rapide, elle peut embarquer plus de poids.
Les inconvenients de la puissance.
La roue arrière a tendance à perdre de l'adhérence à chaque accélération. Le phénomène est accentué lorsque la chaussée est humide.
But de ce formulaire
Vous indiquer en dessous de quelle vitesse la puissance maxi est inutilisable.
Mode d'emploi du formulaire
Choisissez l'état de la route, celui-ci induit un coefficient de frottement ou déterminez vous même votre coefficient ( toujours
Entrez la puissance de votre moto en chevaux-vapeur (CV)
Entrez la masse roulante (moto, pilote, passager(ère), bagages).
Cliquez "calculer".
Le formulaire calcule la vitesse en dessous de laquelle la puissance est inutilisable.
pour moi il m'indique une vitesse de 190km/h et pour vous ?
-



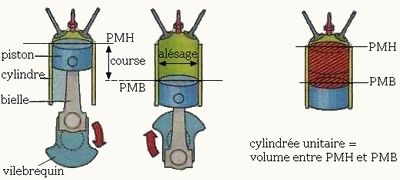
Pratique : Bien choisir son casque moto
dans Forum Technique
Posté(e)
Voilà une question que tout utilisateur de moto ou scooter se pose régulièrement, débutant en phase d'équipement, motard expérimenté remplaçant son vieux casque usagé... Comment bien faire son choix et son essai avant l'achat ?
Le choix et l'achat d'un casque de moto ou scooter, qu'il soit du type intégral, jet, full face ou encore modulable, répondent finalement toujours aux mêmes questions : l'utilisation qui en sera faite, le type de moto ou scooter sur lequel il sera porté, son homologation, son prix, sa technologie, les préférences esthétiques de son acquéreur ou encore ses spécificités morphologiques, soit la forme de son crâne, pour ne citer que l'essentiel. Autant de facteurs qui pourront désarçonner les uns, pire leur faire faire une mauvaise affaire, alors que pris séparément et avec méthode, ils seront les meilleurs garants d'une vie longue et heureuse, coiffé(e) dignement, confortablement et en toute sécurité.
Choisir son casque
Les différents types de casques
Quel casque pour quelle utilisation ? Voilà la première question à se poser avant l'achat. Certes, un casque se choisit en fonction de son budget, mais aussi et surtout de son utilisation et du type de moto ou scooter sur lesquels il va être porté.
Petites cylindrées, motos et scooters
Le casque jet
Le plus basique des casques pour moto et scooter est aussi le plus économique. Le jet est très représenté dans toutes les marques, et offre aussi la plus grande diversité de prix, de quelques dizaines d'euros pour les casques de supermarché à plusieurs centaines pour les modèles haut de gamme italiens, japonais ou allemands. Le jet est le casque urbain par excellence, destiné aux petits parcours peu rapides. Son manque de protection contre le vent devient vite pénible à vitesse soutenue et en croisière, d'autant que le casque a tendance à se soulever en tirant systématiquement sur la jugulaire... Bien sûr, sa forme est aussi à l'origine de son autre gros point faible : une protection aléatoire en cas d'accident.
Casque jet moto ou scooter, l'essentiel
Prix : très large fourchette, de quelques dizaines à plusieurs centaines d'euros
Offre : tout aussi large que leurs prix, du bas au haut de gamme
Deux roues : pour les petites et moyennes cylindrées peu rapides, moto ou scooter
Confort : à privilégier surtout l'été et par temps sec, eu égard au manque de protection faciale (penser aux lunettes !)
Sécurité : malgré leur homologation, les jets offrent une protection faciale quasi nulle
Toutes motos, tous scooters, sauf sportives
Le casque Full Face
Sorte de jet évolué, le casque Full Face solutionne un défaut majeur du genre : sa généreuse visière frontale (d'où son nom) protège son utilisateur du vent, lui permettant ainsi de rouler plus confortablement par toutes saisons et à vitesse soutenue sur de longues étapes. Le Full Face est donc un cran au dessus du jet classique en terme de fabrication, et se trouve dans de nombreuses marques, notamment japonaises haut de gamme (Shoei, Arai). Comme le jet standard, le Full Face offre une faible protection faciale en cas d'accident. On le privilégiera donc sur des motos ou scooters à vocations urbaine, utilitaire ou routière plus que sportive. Néanmoins, la marque allemande Schubert a récemment amélioré la sécurité offerte par ce type de casque en intégrant une barre de protection au niveau de la mâchoire sur son modèle Full Face J1. Une idée à priori simple qui devrait attirer l'attention d'autres fabricants.
Casque full face moto ou scooter, l'essentiel
Prix : plus chers que les jets, mais là aussi dans une large fourchette
Offre : assez large, chaque grande marque en propose au moins un
Deux roues : toutes motos et scooters, sauf sportives
Confort : la visière frontale étend son rayon d'action, toutes saisons et toutes cylindrées
Sécurité : comme les jets, les Full Face offrent une protection faciale quasi nulle
Toutes motos, tous scooters
Le casque modulable
Apparu assez récemment chez quelques fabricants, le casque modulable, comme son nom l'indique, offre la possibilité de se transformer à volonté en jet ou intégral. Mais attention : cette fonctionnalité est surtout utile pour les porteurs de lunettes, généralement peu avantagés par des intégraux classiques. Voilà qui veut dire que si ses casques (type Shoei Multitec ou BMW S4 par exemple) offrent la possibilité de relever la partie avant lorsqu'on les chausse ou par exemple lors d'un arrêt au feu (utile l'été !), celle-ci doit être impérativement rabaissée et verrouillée pour assurer une protection efficace (dans le cas contraire, le casque tend en outre à basculer vers l'avant sous le poids de la partie basculante). En parallèle, des modèles de casque tels le dernier Shark Evoline permet cette fois de profiter des deux fonctionnalités, jet/intégral, même en roulant.
Casque modulable moto ou scooter, l'essentiel
Prix : une fourchette généralement typée milieu/haut de gamme
Offre : disponibles chez les grande marques essentiellement, peu de modèles
Deux roues : toutes motos et scooters
Confort : digne d'un casque intégral, le poids en plus (en raison de la partie basculante et de son mécanisme)
Sécurité : les fabricants promettent une protection égale à celle d'un intégral classique
Le casque intégral
Incontournable de l'équipement du motard, le casque intégral est largement représenté chez tous les fabricants et offre une formidable diversité de prix, de formes, de fabrications et de matériaux, du plastique injecté à la fibre de verre, en passant par les fibres carbone ou composite. C'est assurément le casque à tout faire, même s'il se destine davantage aux utilisateurs de motos et scooters de moyennes et grosses cylindrées. Sa protection optimale contre les chocs, le vent et le froid lui vaut aussi de proposer le meilleur confort, même si là encore tout est souvent question de prix. En été, on appréciera davantage des aérations bien étudiées qu'un intérieur douillet. Bon à savoir, les marques "bas de gamme" proposent généralement deux tailles de calottes contre trois ou plus pour les modèles haut de gamme, ce qui évite de ressembler à E.T. lorsqu'on possède une petite tête...
Casque intégral moto ou scooter, l'essentiel
Prix : large fourchette, de quelques dizaines à plusieurs centaines d'euros
Offre : tout aussi large que leurs prix, du bas au haut de gamme
Deux roues : toutes motos et scooters
Confort : hormis son aération difficile l'été en ville, le casque intégral présente le meilleur confort d'utilisation
Sécurité : là aussi, difficile de faire mieux en terme de sécurité... en attendant le casque air bag !
Vous portez des lunettes ?
Si vous portez des lunettes, les casques dits modulables vous faciliteront la vie. Ils ont été conçus pour cela. La mentonnière relevée permet de plus facilement glisser les branches des lunettes. Mais n'oubliez pas que certains intégraux possèdent des " gouttières " pour laisser passer les branches de lunettes, comme les Shoei (entre autres).
Vous roulez sur piste ?
Si vous faites du circuit, les ventilations doivent aérer efficacement le casque et chasser au mieux la buée. La marque Shark figure parmi les références en matière de traitement de la buée lors des utilisations racing. Surtout depuis le développement de la gamme RSR.
Vous êtes un baroudeur pur et dur ?
Certaines marques pensent aux motards roulant en trails, et adeptes des longues virées sur piste. Ils proposent ainsi des casques typés TT, mais dotés d'une large visière type intégral et amovible. Par ailleurs, les différentes pièces du casque peuvent être démontées pour l'adapter au mieux à chaque utilisation (modèles BMW Enduro, Shoei Hornet DS).
Dans le magasin
Bien essayer son casque
Vous vous êtes décidé(e) pour un modèle de casque bien précis, en fonction de votre utilisation et de votre budget. Voici les consignes à appliquer au moment de l'essai en magasin pour vous garantir le meilleur achat possible.
Primordial : Choisissez le bon casque à la bonne taille !
Que ce soit pour un jet, un intégral, un full face ou un modulable, vous devez en premier lieu vous assurer de choisir la bonne taille, car passé les trois enfilages et les trois minutes d'essai en boutique, vous signez pour une utilisation de plusieurs mois à plusieurs années ! De la bonne taille du casque dépend directement son confort non seulement statique mais aussi dynamique. Comment se sentir à son aise lorsque les mousses vous compriment le front où qu'elles empêchent le casque de venir se plaquer sur votre nez à plus ou moins grande vitesse ? En outre, de la bonne taille du casque dépend aussi sa protection : il ne risquera pas de se déchausser lors d'un choc (sous réserve d'une jugulaire correctement ajustée). Attention, il faut aussi retenir que les marques bas de gamme proposent généralement deux tailles de calottes seulement, ce qui risque de vous handicaper si vous possédez une petite tête, avec la désagréable impression de ressembler à E.T. en raison d'un casque au volume disproportionné (dans ce cas, ses mousses intérieures sont très épaisses). Les marques davantage haut de gamme proposent au moins trois tailles de calottes afin de mieux s'adapter aux différentes morphologies (de XS à XL) en limitant "l'effet grosse tête et casque en plomb". C'est le cas de Shoei par exemple.
Mesurer son tour de tête
Plusieurs paramètres sont à prendre en compte. Pour connaître votre tour de tête, rien ne remplace le mètre de couturière souple qui va mesurer cette judicieuse circonférence. Grosso modo, même si cela dépend de la morphologie du crâne (rond, carré, étroit, allongé...), on mesure le tour de tête au milieu du front en passant par la partie la plus imposante à l'arrière de la tête. On retient la valeur la plus significative (exemple 56 cm).
Essayer un casque
Un casque ne doit pas faire souffrir lors de l'enfilage. Votre tête doit passer sans effort "anormal", comprenez par là une sensation de frottement trop important avec la peau, les oreilles...
Ensuite, une fois en place, le casque doit pouvoir être légèrement ajusté, de quelques centimètres maxi, selon un axe vertical uniquement. S'il bouge sur un plan horizontal c'est peut être que la taille ou la forme de l'intérieur ne convient pas.
Vous devez ressentir une sensation de maintien sans aucune compression "anormale". Il faut surtout bannir l'impression de compression au front et cela peut se vérifier lorsque vous retirez le casque. S'il vous laisse une trace rouge visible, ne choisissez pas ce modèle. Cette pression, désagréable en statique, deviendra insupportable en roulant avec la pression du vent.
Attention, certains modèles comme les Shoei sont ajustés au plus serré au niveau des mousses, avec cette sensation de vous compresser les joues notamment. C'est au vendeur dans ce cas de vous avertir des spécificités propres à chaque marque. Toujours dans le même ordre d'idée, vous ne devez pas non plus avoir la sensation de vous mordre les joues (tout est relatif) ! Rassurez-vous, dans la plupart des cas, ces mousses vont se tasser à l'usage. Là encore, le vendeur doit vous conseiller. En outre, certaines marques proposent des mousses latérales de différentes épaisseurs (les bons magasins en ont même en stock), afin d'adapter les casques à la morphologie de chacun, si besoin.
Ensuite, quand le casque est bien ajusté (le bord du calotin juste au dessus des sourcils), tenez-le ou faites-le tenir fermement par un vendeur par exemple, et tentez de faire tourner votre tête à l'intérieur (légèrement, pas de faire un tour complet !). Si le casque est bien choisi, vous ne devez pas pouvoir bouger plus de quelques millimètres.
Enfin, c'est un conseil tout bête, mais la première impression, celle qui ne dure que dix secondes, est souvent révélatrice. Soyez très attentif à cet instant ! Un casque qui vous paraît très "chausson" lors de l'enfilage tout en conservant cette impression au bout de dix secondes est bon signe. Bonne chance !